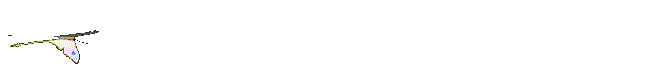Antoine KEVISA
Deuxième page de nouvelles...
SOMMAIRE
Les bons comptes font les bons amis
Les briseurs de rêves
Sacré Lulu !
Mon cœur italien
Les bons comptes font les bons amis
Les leçons ne servent généralement qu'à ceux qui les donnent.(Pierre Dac)
La journée de jeudi a été particulièrement agitée à Cudos, un petit village de 700 habitants, situé en Gironde à soixante-dix kilomètres de Bordeaux. Jusqu'à vingt-deux heures où le calme est revenu, les badauds se sont agglutinés devant une maison de l'agglomération inspectée depuis le milieu de l'après-midi par les gendarmes renforcés par des enquêteurs de la police bordelaise. Dans cette habitation du nouveau lotissement des mimosas, le corps sans vie d'une femme de quarante ans a été découvert, le crâne défoncé. Selon une amie de la victime, qui a découvert le cadavre et alerté la gendarmerie, les abondantes traces de sang sur une longue distance entre la chambre à coucher et le couloir laisseraient supposer que Madame Séverine Castet a tenté d'échapper à son meurtrier, après avoir été agressée dans son lit, puis achevée avec une sauvagerie inouïe à l'aide d'un objet contondant. Toutes les personnes que nous avons pu interroger sur place témoignent d'une vive émotion face à ce dramatique événement sans précédent dans cette petite localité peu habituée à tant d'effervescence. En dehors des journées nationales du patrimoine qui, une fois l'an, organisent le débarquement de touristes "culturels" venant visiter la chapelle d'Artiguevieille et l'église Saint Jean Baptiste, datant respectivement des 13ème et 14ème siècles, Cudos n'attire guère l'attention des étrangers. Même les marcheurs et vététistes venus de Bordeaux et des environs qui parcourent le week-end les chemins de randonnées longeant le Ciron et le Barthos, les deux cours d'eau traversant la commune, ne parviennent pas vraiment à sortir le village de sa paisible somnolence. L'économie, basée sur l'agriculture, l'élevage et l'exploitation du bois des forêts, n'a jamais atteint un niveau qui aurait pu favoriser une délinquance significative ou un climat d'insécurité alarmant. Cudos est donc une petite localité tranquille, avec ses problèmes quotidiens, ses querelles de voisinage et ses rivalités ou inimitiés qui n'ont d'autres conséquences que quelques médisances, rumeurs et fâcheries. Rien ne la préparait donc au profond bouleversement qu'a provoqué la nouvelle de ce crime. Il ne fait aucun doute que l'affaire ne manquera pas, pendant longtemps encore, d'alimenter les conversations de ses habitants, bien que l'enquête ait rapidement abouti à l'interpellation de Dominique Castet, l'époux de la victime dont celle-ci était en instance de divorce. Le meurtrier présumé a été transféré, quelques heures après, de la gendarmerie de Cudos au siège du SRPJ de Bordeaux, avant d'être déféré au parquet et écroué à la prison de Gradignan. Bien que l'arme du crime n'ait pas encore été retrouvée, il apparaît que les lourdes présomptions pesant sur Dominique Castet reposent sur des témoignages concordants et incontestables. Il ressort qu'à l'heure du décès définie par l'examen médico-légal, soit 23 heures, Dominique Castet a rendu visite a son épouse et provoqué un esclandre qui a attiré l'attention des voisins qui l'ont formellement identifié et noté son état d'ébriété manifeste. Avant de quitter les lieux, Dominique Castet a commis des dégradations sur la voiture de son épouse à coups pieds en vociférant des menaces de mort. Plus tôt dans la journée, il y avait déjà eu une altercation entre eux, à la mairie de Cudos où Séverine Castet était agent communal. Des collègues de Séverine Castet et le Maire lui-même avaient dû expulser par la force l'intrus, craignant que son extrême agitation ne dépasse le stade des injures pour déboucher sur une agression physique.
Il semble également que l'intempérance et l'agressivité de Dominique Castet aient été bien connues de l'entourage du couple, sans laisser toutefois entrevoir une issue fatale. Par ailleurs, un autre trait dominant de son caractère, attesté par plusieurs proches, serait son inclination pour les jeux d'argent qui l'aurait conduit à contracter d'importantes dettes le plaçant dans une situation financière des plus délicates. Alors qu'il avait quitté le domicile conjugal depuis trois mois pour s'établir dans la ville voisine, à Bazas, chez sa maîtresse avec qui il entretenait une relation ancienne et notoire, ce serait pour des motifs pécuniaires qu'il a, à plusieurs reprises pendant les semaines précédant le drame, harcelé son épouse. Il tentait de la convaincre de se défaire de la maison de Cudos et de partager avec lui le produit de la vente, sans attendre le jugement de divorce qui aurait selon toute vraisemblance attribué à l'épouse abandonnée la propriété de ce bien. Un refus catégorique lui a été invariablement opposé, occasionnant à chaque fois de violentes disputes rapportés par de nombreux témoins. Il est donc légitime de supposer que cet épineux sujet ait été, une dernière fois, matière à affrontement au cours de la tragique soirée de mercredi.
Le défenseur de Dominique Castet, Maître Gilbert Noailles, que nous avons joint par téléphone a indiqué que son client niait toute implication dans le meurtre de son épouse. Me Noailles a précisé Dominique Castet avait reconnu avoir endommagé le véhicule et proféré des menaces sous l'emprise de l'alcool, mais catégoriquement démenti avoir pénétré dans la maison et a fortiori avoir eu un contact avec son épouse le mercredi soir. La porte serait, d'après ses dires, restée close et personne n'aurait, à aucun moment, répondu à ses appels, ce qui ouvrirait, toujours selon l'avocat, une autre piste que celle privilégiée par les enquêteurs, un meurtre commis par un tiers, avant l'arrivée de Dominique Castet sur les lieux. Me Noailles a conclu notre entretien en affirmant qu'il demeurait confiant quant à la mise en lumière de la vérité et comptait fermement sur la perspicacité et la célérité de la police judiciaire, pour l'arrestation rapide du véritable coupable et la mise hors de cause de son client dans les meilleurs délais.
Cette théorie d'un deuxième homme n'a pas convaincu le juge Isabelle Martinaud qui a mis en examen Dominique Castet pour assassinat.
D'habitude, je ne lis pas le journal. Mais comme la plupart des habitants de Cudos j'ai cherché dans l'édition de samedi de Ouest-France l'article qui relate l'assassinat commis trois jours auparavant. Et comme nous sommes les plus proches voisins des Castet, c'est le défilé des pipelettes à la maison. De la femme du maire à la charcutière, en passant par la présidente du club d'activités paroissiales, tout le monde y met son grain de sel et tient à glaner des informations et à nous faire profiter de son avis éclairé: Elle ne méritait pas ça, elle avait eu de la constance de supporter pendant dix ans un bon à rien, fainéant, ivrogne, joueur et violent, elle n'avait que des amis, elle était si gentille… Tu parles ! J'écoute toutes ces conneries sans répondre. Je préfère ne pas dire ce que je pensais de cette bonne femme qui ne valait pas mieux que son salaud de mari.
J'avais un chien, Nooky. Une race indéfinissable de gros chien. Il n'était pas du tout méchant mais il avait le gros défaut de courir après les voitures en aboyant. Cela énervait mon voisin. Pour Nooky, c'était un jeu. Dès le matin, il était à l'affût, attendant que Castet et sa femme démarrent. Il avait une horloge dans la tête. Dès qu'ils avaient franchi le portail, il s'élançait au côté du véhicule en jappant et en faisant mine de mordre les pneus. Il l'accompagnait jusqu'au bout de la rue puis revenait tout fier, haletant et remuant la queue. C'était plutôt amusant. Je n'ai jamais compris pourquoi ils en avaient fait toute une histoire. Toutes les deux m'avaient dit de garder mon sale cabot, qu'il allait provoquer un accident. Mme Castet m'a même menacé de le faire envoyer en fourrière. Il n'y a pas de fourrière à Cudos, mais je sais que des chiens errants ont déjà été ramassés par un service d'une autre commune à la demande du Maire. Comme cette peau de vache travaillait à la mairie, j'ai pris ses propos au sérieux. Pendant quelques temps, Nooky est resté attaché aux heures où les Castet sortaient ou rentraient de chez eux. Et puis, je lui ai rendu sa liberté. Et lui a recommencé son jeu favori. A chaque fois que, le soir, je le voyais se précipiter dans la rue déserte, je savais qu'il avait entendu bien avant nous le bruit d'une des voitures des Castet arriver.
Un dimanche après-midi, j'étais devant la maison avec Nooky. Je l'ai vu se ruer au dehors et quelques secondes après, il escortait la voiture de Castet dans un récital d'aboiements plus joyeux qu'agressifs. Ça s'est passé juste à ma hauteur: J'ai parfaitement vu la voiture faire un écart sur la gauche pour venir accrocher Nooky de l'aile droite. Celui-ci a poussé un bref jappement plaintif et a été propulsé en tourbillonnant sur le bas côté de la route. J'ai couru vers lui. Il était déjà mort. Un filet de sang s'écoulait de ses naseaux. Castet ne s'est même pas arrêté. Il a d'abord garé son véhicule dans sa cour avant de revenir quelques pas en arrière me hurler des reproches:
- Ça devait arriver ! J'avais toujours dit que ce clébard était un danger public ! Au moins, ça servira de leçon !
Pas un mot d'excuse, pas un regret. Il était simplement furieux. Je suis presque sûr qu'il était ivre, comme la plupart du temps. Et absolument certain qu'il a fait exprès de percuter mon chien. J'ai enterré moi-même Nooky au fond du jardin et j'ai préféré faire semblant de croire que c'était un accident.
Quelques semaines plus tard, Sassie, une petite chienne labrador a remplacé Nooky. Elle n'avait pas la manie de Nooky avec les voitures; Il n'y a donc eu aucune inquiétude au début. C'est au retour de la belle saison que les choses se sont gâtées. Les Castet avaient installé un système d'arrosage automatique enterré dans leur jardin. A la levée du jour et à la tombée du soir, les jets se déclenchaient. Et Sassie, n'écoutant que son atavisme de chien d'eau, partait en fête ! Elle courait, sautait en essayant d'attraper dans sa gueule les gerbes d'eau tournoyantes, ne refermant les mâchoires que sur du vide et quelques gouttes, se roulait sur l'herbe mouillée, folle de bonheur… Et les problèmes recommencèrent ! Les Castet accusèrent Sassie de massacrer leurs massifs de fleurs et reprirent leur litanie de propos malveillants. La propriété des Castet, pas plus que la nôtre, n'était parfaitement close et Sassie trouvait toujours un passage pour rejoindre son théâtre d'eau. Si nous vivons à la campagne, ce n'est pas pour nous barricader dans des forteresses !
Un matin tôt, par le fenêtre, j'ai vu Mme Castet jeter des aliments à Sassie par-dessus la barrière de séparation de nos deux terrains. J'ai été surpris de cette attention, car la veille encore elle avait chassé Sassie de son jardin en tentant de lui donner des coups de balais. Je suis allé voir de plus près, mais Mme Castet était déjà repartie et la chienne avait tout mangé. Le soir, Sassie avait disparu. Après l'avoir appelée et recherchée dans les environs, jusqu'à la forêt proche, je l'ai découverte sous l'abri à outils. Elle s'y était dissimulée pour mourir. Elle avait été empoisonnée. Je l'ai enterrée près de Nooky. Une fois de plus, conscient de ne pouvoir prouver les accusations que j'aurais pu formuler, j'ai gardé mes certitudes pour moi, la mort dans l'âme et la rage au cœur. Une autopsie aurait pu démonter l'empoisonnement, mais pas identifier la coupable. Et puis, par chez nous, on ne fait pas tout un plat pour si peu, pour un vulgaire chien…
Tout cela s'est passé il y a plus d'un an. Quand Castet a déménagé, j'ai été soulagé d'être débarrassé d'un fumier pareil. Mais sa femme qui était du même acabit représentait toujours une menace. J'ai donc renoncé à ce qu'un autre animal prenne la succession de Nooky et Sassie.
J'ai vraiment hâte que cesse ce ballet de commères. Dans ce flot de ragots, d'appréciations et d'hypothèses plus stupides les unes que les autres, j'ai toutefois noté un élément qui a retenu mon attention: pas une personne n'accorde le moindre crédit aux protestations d'innocence de Castet. Tout le monde l'a condamné sans une hésitation, bien avant son procès. Il faut dire que ce sinistre individu a tout du coupable idéal. Castet innocent ! Quelle idée ridicule ! Et pourtant… Je sais bien qu'il est innocent, puisque c'est moi qui ai tué sa femme.
Je n'ai rien prémédité. Ça n'a été que le résultat d'une pulsion subite. Mercredi soir, je regardais un film sur le téléviseur de ma chambre. Un film pas très intéressant. Le personnage principal traînait un chien partout avec lui. Ça m'a rappelé Nooky et Sassie et toute ma haine contre les Castet m'a à nouveau submergé. Par la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir de la lumière au premier étage chez mes voisins. Je savais qu'elle provenait de la chambre où dormait Mme Castet. J'avais remarqué qu'en ce mois de juillet, la porte-fenêtre restait ouverte toute la nuit à cause de la chaleur étouffante. J'ai pris ma décision. J'ai attendu près d'une demi-heure après que la lumière se soit éteinte, pour m'assurer qu'elle s'était endormie. Je me suis saisi d'une batte de base-ball qui faisait simplement office d'objet décoratif, mais était suffisamment lourde et solide pour me servir d'arme. J'ai enjambé ma fenêtre, puis la clôture sur l'arrière du terrain dans la zone la plus obscure et je me suis approché avec précaution de la maison des Castet. Juste devant la chambre concernée, il y a un peuplier dont l'une des branches les plus hautes et les plus solides atteint le balcon du premier étage. Mon ascension ne fut pas très difficile, malgré l'encombrement de la batte. Le moins aisé fut de passer de l'arbre au balcon sans faire aucun bruit. A l'intérieur, tout était silencieux. J'ai écarté doucement le rideau en voilage qui ondulait doucement à la brise et je me suis glissé dans la chambre. Malgré la clarté lunaire, j'ai mis quelques secondes à distinguer l'intérieur de la pièce et à me repérer. Je ne voulais surtout pas heurter un meuble et réveiller Mme Castet. Lorsque ma vision fut adaptée à la pénombre, je suis venu près du lit. J'ai allumé la lampe de chevet et je me suis tenu prêt, la batte levée, serrée à deux mains. Mme Castet a émis un grognement et plissé les yeux, avant de les ouvrir et de me regarder avec incompréhension. Elle avait repoussé le drap au pied du lit et portait une chemise de nuit presque transparente. Mais ça je m'en foutais complètement ! Je n'étais pas venu pour l'admirer.
Encore à moitié endormie, elle devait se demander si ma présence n'était pas un rêve.
- Mais qu'est-ce que…
Je ne l'ai pas laissé terminer.
- Salope !
J'ai frappé avec une force dont je ne me serais jamais cru capable. La batte s'est abattue en travers sur son visage qui a immédiatement inondé de sang au niveau de la bouche, du nez et du front. Elle a poussé un cri rauque mais n'a pas hurlé. Je pense que ses dents cassées et le sang qu'elle avalait l'ont en empêchée. Mais j'ai eu peur qu'elle ameute le quartier. Alors j'ai frappé à nouveau. Plusieurs fois. Elle avait eu le temps de se protéger de ses bras. A chaque coup, je sentais les os craquer. Et puis, dans un sursaut désespéré, elle s'est levée et m'a bousculé pour tenter de s'enfuir. Je l'ai rattrapée dans le couloir. Je l'ai fait tomber à plat ventre et je lui ai asséné un coup sur l'arrière du crâne. Là encore, j'ai frappé plusieurs fois. Elle ne bougeait plus et une flaque de sang s'élargissait autour de sa tête. A ce moment-là, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant la maison. J'étais complètement paniqué. J'ai pensé que quelqu'un avait entendu les cris de Mme Castet, même étouffés. La sonnette qui a retenti m'a vraiment terrifié, tétanisé. Lorsque, en même temps que les coups impatients sur la porte d'entrée, j'ai entendu la voix qui appelait, j'ai identifié l'arrivant.
- Séverine, ouvre, c'est moi. Bon sang, ouvre. J'ai vu la lumière, je sais que tu ne dors pas. Ouvre ou je défonce la porte.
Pendant tout le temps que Castet est resté là à hurler et à menacer sa femme, je n'ai pas bougé. Quand il est reparti, je suis retourné dans la chambre, j'ai éteint la lampe de chevet et, avec mon tee-shirt j'ai effacé sur l'interrupteur les empreintes que j'avais pu y laisser. J'ai attendu un bon moment que les voisins qui avaient dû être alertés par le raffut de Castet se rendorment. Puis je suis reparti par le même chemin qu'à l'arrivée, prenant soin d'effacer également mes traces sur la balustrade du balcon.
Le lendemain matin, j'ai essayé de nettoyer la batte de base-ball, mais je ne suis pas parvenu à enlever les tâches noirâtres de sang séché. Par précaution, je suis allé à pied à la décharge municipale et j'ai enfoui la tige de bois sous un tas d'ordures destinées à être brûlées. Dans l'après-midi, après la découverte du cadavre, les gendarmes sont venus m'interroger, comme d'autres voisins. Dans la soirée, des policiers en civil venus de Bordeaux m'ont encore posé des questions. Mais pas trop. Je n'ai même pas été convoqué à la gendarmerie. J'ai été questionné à la maison, par pure routine. Je me suis vengé des Castet; j'ai vengé Nooky et Sassie. Maintenant, je vais pouvoir avoir un nouveau chien en toute sécurité. C'est tout ce qui compte. Pour le reste, je ne m'en fais pas. Je ne crois pas que quelqu'un me soupçonne un jour. Après tout, qui soupçonnerait un petit garçon de douze ans ?
Les briseurs de rêves
Lorsque je vois sur les devantures des kiosques à journaux, s’étaler les manchettes racoleuses de la presse à scandale, ces torchons infâmes pudiquement dealés sous l’appellation de presse people, j’ai plus que du dégoût, des accès de révolte, presque des flambées de haine et de violence difficilement réprimées. Comment des journalistes, sans foi ni loi, au mépris de toute éthique et de toute déontologie, peuvent-ils se vautrer dans la fange, fouiller avec délectation dans les poubelles de leurs contemporains, pour peu qu’ils possèdent, ne serait-ce que momentanément, un capital de notoriété négociable ? Ils espionnent, traquent leurs proies pour leur arracher leurs immondes secrets qu’ils jetteront en pâture à un lectorat avide et pervers. Et si leurs investigations ne révèlent aucune tare honteuse, nul adultère, pas la plus petite déviance digne d’intérêt, qu’importe… Ils inventent ! Le public n’attend pas la vérité, il veut du sensationnel !
Bien sûr, personne ne lit ces hebdomadaires gluants de vice ! A peine les achète-t-on pour se convaincre de l’existence d’une telle absurdité malsaine, pour rire de ses voisins crédules mais coupables et pour dénoncer cette ignominie ambiante… Ces briseurs de rêves me répugnent !
Naturellement, je vous imagine soupirer, narquois ou agacés. Vous êtes sans doute convaincus qu’il ne s’agit, une fois de plus, que d’une indignation convenue, du rabâchage d’un discours éculé, et cela à peu de frais, bref des paroles creuses comme en produisent tout vertueux refoulé… Vous vous trompez ! Il ne s’agit pas, en tout cas pas seulement, de morale, de respect de la dignité humaine et de droit à la vie privée. Mon aversion pour ces professionnels des caniveaux est surtout d’ordre personnel. J’ai été moi-même la cible de ces charognards. Et plus important que ma dérisoire personne, un être cher en a été la victime !
Cela s’est passé il y a vingt-cinq ans, juste l’année du bac. J’avais encore beaucoup à étudier pour m’assurer les meilleures chances de réussite, même avec l’excellence de la préparation à Henri IV, un des plus prestigieux lycées parisiens, mais le dilettantisme était déjà un trait dominant de ma personnalité. Ce mercredi après-midi, j’avais donc préféré traîner seul sur les Champs-Elysées. Je n’avais prévu aucun divertissement, ni séance de cinéma, ni visite à des camarades –qui plus sérieux que moi devaient sans doute être en train de bûcher !-, j’avais simplement voulu ne pas demeurer chez moi afin de ne pas me soumettre à la tentation de plonger dans un bouquin de maths ou de physique. En fait, je ne craignais pas tellement que ma conscience torturée me pousse à l’étude, je redoutais surtout les litanies de reproches de ma mère que ma désinvolture exaspérait ! J’avais marché une bonne partie de l’après-midi, sans but mais sans ennui. Me promener, sans contrainte d’horaires et de travail, était à l’époque ma seule ambition.En parvenant près de la Place Cambronne, je notais une plus grande effervescence qu’à l’accoutumée au-dessous du métro aérien, à une heure où les services de la voirie municipale ont depuis longtemps fait disparaître les détritus et les restes d’emballages produits par le marché du matin. Il y avait des barrières métalliques qui déviaient la circulation piétonnière vers les bords des rues encadrant le terre-plein central qui semblait réservé à une troupe assez nombreuse s’agitant en tous sens. Un accident, un attentat ? En me rapprochant, je découvris des installations et un outillage caractéristiques qui me renseignèrent sur l’activité qui se déroulait dans mon quartier . Le site était envahi par des hommes et des femmes évoluant entre des câbles, des projecteurs, une vingtaine de mètres de rails sur lesquels circulait un wagonnet surmonté d’un siège solidaire d’une volumineuse caméra et d’autres équipements dont j’ignorais les noms, mais qui ne laissait aucune place au doute : le tournage d’un film était en cours.
Des curieux s’étaient agglutinés au-delà du périmètre de travail. Parmi eux, se trouvaient également des observateurs dont la présence n’était certainement pas fortuite : bardés d’appareils photographiques à téléobjectifs, ils mitraillaient tous en même temps, par intermittence, un point précis du plateau que je ne pouvais encore apercevoir. Me mêlant à eux, je découvris l’objet de leur attention. Je me souviens très bien, après toutes ces années, du choc, de l’éblouissement, de l’émerveillement ressenti : l’actrice principale de ce film, c’était ELLE !
Non, n’attendez pas de moi, compte tenu de la suite de cette histoire, que je vous livre son nom. En aucun cas, mon attitude ne saurait se comparer à celle des vautours que j’exècre ! Ma discrétion restera sans faille ! Sachez seulement qu’ELLE était une immense vedette à l’époque et qu’elle le demeure aujourd’hui, et pas seulement pour les gens de ma génération ! Je n’ai jamais été très cinéphile, même dans ma jeunesse, mais je savais tout d’ELLE. J’aurais pu être son biographe, j’étais –et je suis toujours- un spécialiste de sa carrière et de sa vie. J’ai vu chacun de ses innombrables succès des dizaines de fois, j’ai conservé religieusement tous les articles qui lui ont été consacrés, exceptés naturellement ceux publiés dans ces torchons malfaisants…
C’était un film policier, que j’ai vu et revu par la suite avec une ferveur toute particulière. ELLE était poursuivie par un homme armé. Des figurants tenaient les rôles de passants qu’ELLE appelait à l’aide et qui s’empressaient de s’éloigner de la menace du revolver . Il y eut plusieurs prises. La voix tonitruante du metteur en scène interrompait la séquence pour toutes sortes de motifs.
-« Coupez ! »
Des figurants ne s’enfuyaient pas assez viteou c’était le poursuivant qui était trop lent ou trop rapide, ou alors c’était ELLE qui n’était pas dans le rythme, ELLE n’était pas tombée suivant les indications, elle ne s’était pas retournée quand il le fallait… J’assistais à ces péripéties sans qu’elles me passionnent vraiment. J’étais et je suis fasciné par ELLE. Pour moi, ELLE a toujours été plus qu’une star, ELLE est mon idole, mon idéal féminin… J’ai ressenti sa nervosité au fur et mesure des prises successives. Un échange de propos aigres-doux entre ELLE et le réalisateur amena celui-ci à signifier une pause d’un quart d’heure à l’ensemble des comédiens et des techniciens. Je discernais plus qu’un simple énervement. ELLE était épuisée, à bout de nerfs. Franchissant le cordon métallique elle traversa le boulevard de Grenelle et pénétra dans un café tout proche. Les photographes l’avaient suivie et faisaient crépiter leur flashes. Sans réfléchir, je lui avais moi aussi emboîté le pas.
Peut-être sur sa demande à ELLE, ou de la propre initiative du patron, les paparazzi avaient été refoulés de la salle et assignés en terrasse. Pour ma part, j’avais miraculeusement trouvé place à une table voisine de la sienne.
Plusieurs personnes participant au tournage l’avaient rejointe mais avaient été fraîchement accueillies et ne s’étaient pas attardées. Je l’ai vue retenir ses larmes, sans y parvenir entièrement. A-t-ELLE senti que je la fixais ? Son regard a accroché le mien. J’ai lu dans ses yeux une profonde détresse et un appel au secours. Puis, le metteur en scène s’est attablé à son tour face à elle. Je n’ai pas entendu ce qu’il lui disait, mais je l’ai entendu, ELLE, répliquer vivement, avant d’éclater en sanglots :
-« Assez ! Fous moi la paix ! »
Elle s’est levé précipitamment et s’est dirigée vers les toilettes, alors que les obsédés de la pellicule continuaient à la prendre en photo, à travers la vitrine du Café. C’est en voyant la moue méprisante de ce butor qui la suivait du regard en secouant la tête, que je me suis décidé. Sans savoir ce que j’allais faire, je suis descendu au sous-sol. J’ai attendu quelques minutes devant la porte des toilettes des femmes. Lorsqu’ELLE est ressortie, elle a eu un haut-le-corps en manquant de me heurter. Je restais planté devant ELLE, dans l’impossibilité totale de proférer le moindre mot. ELLE m’a regardé et s’est remise à pleurer. D’une voix implorante, ELLE m’a simplement chuchoté :
-« S’il vous plaît, aidez-moi, appelez un taxi. Je veux m’en aller…. »
-« Oui. Retournez à votre table. Je vous préviendrai… »Un peu plus tard, alors qu’ELLE avait demandé un petit délai supplémentaire pour se concentrer en vue d’une énième prise, je retournais dans la salle pour l’avertir de loin, d’un signe de tête, que son taxi l’attendait, devant l’autre accès du Café, rue du Laos.
Je me serais contenté de cet épisode et de la regarder partir pour toujours, heureux d’avoir fait partie de sa vie pendant quelques minutes… Lorsque, installée dans le véhicule, ELLE m’a invité à la rejoindre d’un geste pressant, je n’ai pas davantage analysé la situation que précédemment. ELLE a donné au chauffeur l’adresse du Méridien Montparnasse. Personne n’a tenté d’empêcher notre départ. Apparemment, nul ne s’en était aperçu. Lorsque l’équipe du film comprendrait qu’elle s’était éclipsée, elle serait depuis longtemps dans le réconfort de sa chambre d’hôtel. Je savourais le privilège d’être assis à son côté, sans rien exiger ni même espérer de plus. Je supposais qu’ELLE m’avait « embarqué » pour me soustraire, le cas échéant, à la rage de son metteur en scène, au cas où un témoin de ma complicité m’aurait dénoncé. Je savais que ce voyage merveilleux prendrait bientôt fin. Nous avons effectué le court trajet sans échanger un mot. Arrivés rue du Maine, devant l’entrée du Méridien, j’avais le cœur étreint par l’imminence de la séparation. Je ne savais même pas quelle formule employer, j’étais désespéré de devoir la quitter sans avoir le courage de lui déclarer mon admiration, sinon l’adulation que je n’aurais jamais eu l’audace de lui avouer…
Si ELLE avait su dissimuler sa fuite à l’équipe de tournage, d’autres avaient été plus vigilants : une nuée de paparazzi se matérialisa soudain devant nous, faisant usage de leur attirail aveuglant. ELLE a poussé un cri de surprise paniquée et a levé les bras devant son visage, dans un geste de défense et d’impuissance. Par un réflexe protecteur, je me suis jeté sur ces agresseurs pour les repousser. Dans la bousculade qui s’en est suivie, ma chemise a été déchirée, mais nous avons réussi à nous réfugier dans l’hôtel. Là encore, les intrus ont été interdits d’entrée par le personnel, soucieux de la tranquillité de leur établissement et de leur clientèle. Dans une chambre au 3ème étage, ELLE m’a considéré d’un air navré :
-« Retirez votre chemise. Elle est fichue. Je vais demander à la réception de vous en faire monter une. »
ELLE me l’a ôtée ELLE-même. Pétrifié, je sentais ses doigts m’effleurer. Je ne pouvais pas croire à ce qui m’arrivait : J’étais dans une chambre avec ELLE, et ELLE me déshabillait… ELLE qui avait provoqué mes premiers émois d’adolescent, qui me suscite encore chez moi la nostalgie d’un monde merveilleux à peine entrevu…
De légers coups frappés à la porte nous firent penser que le garçon d’étage avait fait diligence pour nous apporter le vêtement demandé. En fait, à peine la porte ouverte, l’éclair d’un flash témoigna du harcèlement sans pitié de ces individus ! Un cliché de la star, avec un jeune homme de quinze ans son cadet qui l’avait enlevée en plein tournage de son dernier film et qui se trouvait à moitié dénudé dans une chambre d’hôtel avec ELLE, voilà qui devait être un coup de maître du point de vue de cette espèce nuisible !
ELLE a claqué violemment la porte et s’est effondrée à genoux, le visage enfoui entre ses mains, en laissant échapper une plainte douloureuse. Je me suis agenouillé face à ELLE, balbutiant, n’osant la toucher, ne sachant comment la consoler… ELLE a découvert son visage et m’a regardé tristement. Lentement, ELLE s’est relevée et m’a pris la main, m’obligeant à la suivre vers le lit. ELLE s’y est allongé et m’a attiré vers ELLE, toujours sans parler, et…Vous, hommes ou femmes, qui me lisez comme vous feuilletez fébrilement ces magazines odieux, je vous imagine… non, JE VOUS VOIS pourlécher vos lippes plus vicieuses que gourmandes, J’ENTENDS votre souffle accéléré par une excitation vulgaire et pathétique, JE SAIS que vous réclamez que je vous relate par le menu détail la scène dont vous-mêmes n’auriez pu être que des acteurs indigents !
Mais comprendrez-vous jamais que votre pitoyable lubricité est aux antipodes de la pureté de mon rêve ? Etes-vous donc incapables d’appréhender la magie, la caractère sacré de certains moments exceptionnels dans la vie de deux êtres, lorsqu’ils sont sur le point de partager ce que vous ne posséderez jamais ? Empêtrés dans vos bas instincts bestiaux, vous ne pouvez vous élever vers ces sommets d’illumination et de béatitude que je renonce à vous décrire et à vous expliquer !Mais mon rêve a été brisé. Alors, quelle importance maintenant ? Si vous y tenez, je vais vous dire ce qui s’est passé : ma mère m’a secoué dans mon lit et m’a dit :
-Christophe ! Debout ! Ton réveil a sonné il y a déjà une demi-heure ! Tu vas encore être en retard au lycée…
Sacré Lulu !
« Les fantômes existent. Ce sont les parasites de notre mémoire. » André Maillet
Eugène Duffieux dit « Lulu », 75 ans, était certainement le personnage qui comptait le plus à Saint-Fonsin, petit village du Haut-Lubéron de 325 âmes. Une petite minorité applaudissait à chacune de ses incessantes extravagances, l’immense majorité le détestait. Tous guettaient avec enthousiasme ou inquiétude sa prochaine trouvaille en se demandant quelle victime il choisirait…
L’été dernier, une colonie de vacances de jeunes scouts anglais avait établi son campement, avec l’autorisation du Maire, sur le terrain municipal jouxtant sa propriété. Sous le prétexte fallacieux que ses voisins provisoires piétinaient sa pelouse –qui tenait d’ailleurs davantage du champ de mauvaises herbes que du jardin entretenu -, il avait planté face aux envahisseurs britanniques un grand écriteau en carton, sur lequel il avait écrit au feutre gras : « DON’T WALK ON THE GRASS, SMOKE IT » (Ne marchez pas sur l’herbe, fumez-la). Il ne fallait pas chercher dans l’utilisation de ce vieux slogan hippie une quelconque apologie de substances illicites, ni l’éventuelle nostalgie d’excès supposés de sa lointaine jeunesse et encore moins d’actuelles pratiques d’un vieillard indigne, mais simplement la volonté de choquer l’encadrement « collet monté » de cette jeunesse bien sous tous rapports. Dans le même esprit, si d’aventure un groupe de pacifistes s’était substitué aux disciples de Baden Powell, il n’aurait pas hésité une seconde à diffuser par haut-parleurs, de la musique militaire ininterrompue !
A une certaine période, il s’était mis à pratiquer, devant sa maison, un rituel étrange constitué d’incantations en une langue incompréhensible, les yeux au ciel, et de longues séances de méditation, assis à même le sol dans une position rappelant vaguement celle du lotus. Les témoins de ce manège, intrigués, l’avaient interrogé. L’air mystérieux, il détournait la conversation, renforçant la curiosité de ses voisins. Pressé de questions, il avait fini par avouer, après avoir fait jurer le secret, qu’il était un adepte de la secte du Mandarom et que son Gourou, Gilbert Bourdin, alias « le Seigneur Hamsah Manarah », las des tracasseries dont il faisait l’objet à Castellane dans les Alpes-de-Haute-Provence, avait choisi comme nouveau lieu d’implantation la commune de Saint-Fonsin, et plus précisément son terrain ! Le « Messie cosmoplanétaire » allait faire démonter les statues du Christ cosmique et du bouddha Maitreya, hautes de plus de vingt mètres, et les faire transporter à Saint-Fonsin. Lulu ajoutait même, que la construction du « temple pyramide de l'unité » débuterait dans les meilleurs délais ! A l’appui de ses confidences, Lulu montrait volontiers une coupure de presse où figurait une photographie des idoles monumentales, encore érigées, mais plus pour très longtemps, à Castellane. Bientôt chacun à Saint-Fonsin pourrait chanter le « Aum , le son du bonheur », ajoutait Lulu en extase…
Il ne fallut que quelques heures pour que les propos de Lulu fussent portés à la connaissance de la population saint-fonsinienne ! A peu près tout le monde tenait Lulu pour un cinglé, mais justement assez cinglé pour s’être embarqué dans ce genre d’histoire. Tout le village fut en émoi. Des habitants lui rendirent visite pour tenter de le raisonner, le curé en appela au souvenir de son baptême ! Lulu se referma comme une huître et se barricada chez lui durant plusieurs jours, refusant d’ouvrir et de répondre à quiconque ! Puis, répondant à un S.O.S « désepéré » de Lulu, un journaliste de Cavaillon, correspondant local du Figaro, vint le voir pour l’interviewer. Lulu se garda bien de lui révéler que tout ce qu’il savait du Madarom, il l’avait précisément appris en lisant un article de son journal quelques semaines auparavant. Bien au contraire, il affirma n’avoir jamais entendu parler de cette secte et ne pas comprendre le harcèlement dont il était victime de la part de certaines personnes dont il fournit complaisamment les noms au journaliste –les mêmes personnes à qui il avait annoncé la venue prochaine du nouveau messie !-. Lulu, la larme à l’œil se plaignit de ne même plus pouvoir se livrer à ses exercices quotidiens de gymnastique en plein air, devant sa maison. Deux jours plus tard, un article au vitriol du Figaro titrait : « Du commérage à la psychose !». Des saint-fonsiniens, nommément cités, y étaient traités de « corbeaux » et de « gestapistes », alors que Lulu était présenté comme un petit vieux inoffensif sur lequel s’était abattue la bêtise et la méchanceté de ses contemporains !
Eugène Duffieux était un provocateur né, un contradicteur patenté, un emmerdeur professionnel ! Ses congénères le navraient. Il avait donc décidé, depuis fort longtemps, qu’ils le feraient rire, à leurs dépens. Ceux qui, à l’énumération loin d’être exhaustive de ces quelques faits d’armes, imagineraient un vieillard acariâtre, se trompent lourdement ! Le seul but de Lulu est de s’amuser. Vindicatif, certes, mais dans la seule perspective d’une bonne rigolade. La particularité qui distinguait Lulu du commun des farceurs, c’est qu’il n’éprouvait aucun besoin de partager son rire ! Il ne se souciait aucunement que son humour, dévastateur s’il en était, demeurât incompris. Il voulait rire de ceux qui l’entouraient, pas avec eux ! Lulu était une espèce rare, voire unique, de comique misanthrope !
Son ennemi intime, sa tête de turc, était le Maire du village, Pierre Bouchard, dont le père Marcel avait également été maire précédemment. Personne ne connaissait la raison de cet acharnement. Nul n’a jamais pu déceler la moindre logique dans les croisades impitoyables de Lulu ! Il y a quelques années, lors d’une élection municipale, Lulu avait déclenché un séisme politique à Saint-Fonsin : pour la première et dernière fois à ce jour, une liste d’opposition s’était présentée contre celle de Pierre Bouchard ! Elle était conduite et animée par Lulu. Son programme était des plus sommaires et ne restera pas dans les annales de la République : Lulu proclamait : « Mon programme est identique à celui de Bouchard… Je n’en ai pas ! ». Il avait réussi à convaincre quelques saint-fonsiniens d’entrer en rébellion contre la dynastie Bouchard. Le plus facile à entraîner avait été Etienne Rignard, le beau-frère de l’inamovible édile, fâché à mort avec celui-ci depuis une sordide histoire d’héritage… P’tit Louis, n’avait pas non plus fait de grosses difficultés pour intégrer la liste dissidente. Il convient toutefois de préciser que P’tit Louis était à moitié –et même plus qu’à moitié- demeuré et ne faisait pas la différence entre une élection municipale et la kermesse du village… Le sanguin Bouchard avait failli succomber à une crise d’apoplexie en apprenant le crime de lèse-maire que constituait cette déclaration de guerre du fantasque Lulu !
Le jour de l’élection, très tôt, Lulu était sorti de chez lui avec son attirail de pêche et avait installé son pliant sur le petit pont qui enjambe la rivière Mavraine, juste en face de la mairie, là où personne n’avait jamais pris de poisson, ni même eu l’idée de pêcher. Mais venant de Lulu, l’incongruité du choix de cet emplacement n’intrigua personne outre mesure. En revanche, peu avant la clôture du scrutin, chacun commença à s’étonner que Lulu ne soit pas encore venu remplir son devoir citoyen. Plusieurs de ses colistiers, avec à leur tête celui qui était le plus impliqué et le plus motivé, Etienne Rignard, étaient allés le presser… Lulu ne leur avait pas répondu pas, continuant à fixer avec une extrême concentration sa ligne… qui était dépourvue d’hameçon ! Ce ne fut qu’à l’heure exacte de la fermeture du bureau de vote que Lulu se leva, rangea ses affaires… et rentra chez lui sans même s’intéresser aux opérations de dépouillement ! Aucun de ses colistiers ne lui adressa plus jamais la parole, excepté P’tit Louis, bien entendu ! Bouchard avait remporté l’élection avec une écrasante majorité, mais conscient de s’être fait ridiculiser tout autant que son infortuné beau-frère, il découvrit qu’une victoire pouvait avoir un goût d’amertume !
Quelques temps plus tard, Bouchard avait fait, à Cavaillon, l’acquisition d’un caniche de pur race, persuadé sans doute que cet animal distingué convenait mieux à son standing que les vulgaires chiens de chasse ou les bâtards que possédaient ses administrés. Dès lors, lui ou sa femme ne se déplaçaient plus qu’en compagnie de Hannibal, dûment et régulièrement toiletté, comme il sied à un animal de bonne société. Les Bouchard qui n’avaient pas d’enfant prodiguaient au caniche des trésors d’affection, comme s’il avait été leur progéniture. Une semaine à peine s’écoula avant que les saint-fonsiniens médusés virent un étrange équipage déambuler à son tour dans le village : Lulu tenant en laisse… un canard qu’il interpellait ostensiblement sous le nom de « Babal ».
-« Allez viens mon Babal, tu vas te promener avec papa… »
Rituellement, le duo faisait une halte devant la Mairie. Il n’y pénétrait pas, se contentant de stationner sur le perron. Cette escale n’avait rien d’une visite de courtoisie et ne durait jamais très longtemps : on connaît la propension de ces volatiles à baliser leur trajet et la fréquence de ce balisage ! Après que la volaille eut laissé son meilleur souvenir à Bouchard, Lulu donnait le signal du départ :
-« Allez mon Babal, maintenant on va rentrer faire ta toilette… »
Le persécuté Bouchard usa de ses prérogatives municipales et, en représailles, fit intervenir le garde champêtre pour verbaliser le contrevenant à l’hygiène publique ! Lulu riposta en appliquant sur les arbres ceinturant l’unique place du village des affichettes manuscrites qui dénonçaient l’inhumanité et l’arbitraire du Maire :
« Un canard vaut bien un caniche… despotisme… qui n’aime pas les animaux ne peut pas aimer réellement ses concitoyens… ». Il fit même circuler une pétition pour réclamer la liberté du choix de son animal de compagnie. Il ne recueillit guère de signatures dans Saint-Fonsin, si ce n’est celles de P’tit Louis et d’une poignée d’irréductibles opposants du Maire, écroulés de rire et oubliant bien volontiers à cette occasion qu’ils avaient eux-mêmes été dans le passé les victimes, peu ou prou, des facéties sournoises du « vieux toqué ». Pendant quelques jours, Lulu et Babal se firent oublier à la Mairie. Ou presque. Lulu avait été vu, chaque matin, quittant Saint-Fonsin au volant de son antique R4 pour n’y revenir qu’en fin de journée. Bouchard qui espérait, pour une fois, avoir terrassé son adversaire, sans parvenir à s’en persuader entièrement, ne tarda à connaître les raisons de ces mystérieuses escapades. Lulu vint avec un grand cérémonial, la mine exagérément meurtrie, déposer à la Mairie plus de quatre cents signatures en faveur de Babal qu’il avait glanées dans les rues de Cavaillon. Soit plus de pétitionnaires que d’habitants à Saint-Fonsin. Naturellement, cette pétition n’avait ni valeur juridique réelle, ni impact quelconque a priori… si ce n’était d’outrager et de ridiculiser un peu plus le malheureux Bouchard qui reçut le coup de grâce la semaine suivante.. Deux lettres lui parvinrent successivement. L’une émanait de la SPA de Cavaillon, l’autre de l’antenne du Vaucluse de la Fondation Brigitte Bardot. Ces deux associations désiraient des éclaircissements sur une affaire de cruauté envers un animal et une inoffensive personne âgée qui risquait de perdre son seul ami, à cause de l’application intransigeante, sans discernement et injuste d’un règlement municipal ! Lulu, qui avait reçu copies de ces courriers, en avait fait des photocopies et chargé le fidèle P’tit Louis d’en laisser traîner au café dont les piliers égalaient les plus redoutables pipelettes. Très vite, tout Saint-Fonsin fit des gorges chaudes de l’affaire « Babal ». Résigné, au bord de la dépression, Bouchard procéda à un classement vertical de la contravention dressée à l’encontre de Lulu, et celui-ci, le dimanche de cette semaine… mangea du canard. Babal avait rempli sa mission !
Bouchard pensait avoir touché le fond. La suprême humiliation eut lieu l’année dernière… Bouchard au terme d’efforts diplomatiques intenses et de longue haleine, avait réussi à obtenir la présence du suppléant d’un député du Vaucluse pour la commémoration de l’appel du 18 juin. Lulu en avait été averti par la vox populi, peut-être désireuse de susciter une perturbation. Il avait d’abord ricané en songeant :
-« Pour que ce guignol vienne dans ce trou perdu à l’invitation de cet imbécile de Bouchard, il ne doit pas être beaucoup sollicité ! »
Puis il s’était tordu de rire en visualisant la scène qui se déroula effectivement pendant la commémoration…
Ceint de son écharpe tricolore, flanqué de son conseil municipal au grand complet, Bouchard lisait solennellement –ânonnait pensa Lulu !-le texte de l’appel du Général de Gaulle, sous l’attention recueillie du député d’occasion, de quelques officiels qui l’avaient escorté, du seul ancien combattant survivant dans le village et de la quasi totalité des saint-fonsiniens, sevrés de distractions. C’est en plein milieu de l’allocution de Bouchard que Lulu traversa nonchalamment la place, avec une lenteur calculée, passant à une dizaine de mètres du monument aux morts, sans s’intéresser le moins du monde à ce qui s’y passait… et poussa à fond le volume de son magnétophone portatif qui libéra la voix nasillarde et tonitruante d’Annie Cordy :
-« Tata Yoyo qu'est-ce qu'y a sous ton grand chapeau
Tata Yoyo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux
Tata Yoyo, on m'a dit qu'y a même un grelot
Mais, moi j'aime ça quand ça fait ding ding di gue ding
Comme une samba… »
Bouchard roula des yeux exorbités, s’étrangla, perdit connaissance ; on l’évacua dans la précipitation vers le café où on l’allongea à l’ombre de la terrasse ; son premier adjoint qui était presque illettré termina tant bien que mal la lecture en omettant un mot sur deux ; le simili parlementaire et son escorte fuirent plutôt qu’ils ne quittèrent ce village de fous… Et Lulu, paraissant ne pas se rendre compte de la confusion qui régnait alentours, s’éloignait d’un pas paisible, en toute innocence, fredonnant sa joyeuse rengaine :
« Tata Yoyo… »
Après ce dernier attentat portant la marque de Lulu, Bouchard partit un mois en villégiature chez sa belle-famille, dans le Var. Quant il reparut à Saint-Fonsin, il n’était plus le même. Tout le monde constata qu’il avait perdu toute velléité de résistance à Lulu. Quand il le croisait dans le village, il détournait les yeux et passait tête basse, définitivement vaincu. De ce fait, le jeu avait perdu son intérêt et Lulu cessa d’ourdir ses machiavéliques machinations contre son ennemi de toujours. Du moins le pensait-on…
Le mois dernier, Lulu est mort pendant son sommeil. C’est P’tit Louis qui l’a trouvé en lui apportant ses commissions hebdomadaires. Naturellement, Bouchard a assisté à son enterrement, comme il le fait pour chacun de ses défunts administrés. Mais il a laissé son premier adjoint se dépatouiller avec l’hommage funèbre. Il ne fallait pas exagérer tout de même ! La page « Lulu » était tournée… mais le livre pas encore refermé, car la semaine dernière, la nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre à travers Saint-Fonsin : Lulu avait fait de Bouchard son légataire universel ! L’héritage n’est pas extraordinaire, une vieille ferme, mais la terre ça compte dans cette région ! Et c’est tout ce que possédait Lulu ! Un lent mais inexorable retournement d’opinion est en train de s’opérer : De plus en plus de saint-fonsiniens s’accordent à penser –et à clamer !- que Lulu était dans le fond un bon bougre… Déjà, certains se risquent à murmurer que Bouchard n’a pas toujours été tendre avec ce pauvre Lulu et que le Maire est un ingrat ! Rignard, le beau-frère revanchard n’est pas le dernier à orienter ce revirement ! Il y a des élections municipales dans moins de six mois… Bouchard est peut-être en train de vivre la fin de son dernier mandat… Sacré Lulu !
Mon cœur italien
« La vengeance est plus douce que le miel » (Homère, l'Iliade)
Je fréquentais le night-club Giani's depuis un mois environ lorsqu'un incident scella mon amitié avec Giani, le maître des lieux. Un trio manifestement ivre menait grand tapage au bar. Celui qui semblait mener le groupe était un type de taille modeste, mince, le crâne rasé. Il gesticulait et parlait fort, au point de presque couvrir la musique et, en tout cas, de troubler les conversations des tablées voisines. Arrogant, il claquait des doigts en sifflant pour que le barman renouvelle leurs consommations. Sa compagne, une grande blonde plutôt jolie mais l'air très vulgaire, couverte de bijoux aussi faux que clinquants, portait une robe très courte et moulante qui faisait plus que suggérer des formes généreuses. Elle riait en émettant une sorte de stridulation ininterrompue, comme une sirène d'alarme que personne n'aurait su arrêter. Le troisième homme, un peu plus grand que son acolyte et surtout beaucoup plus massif, était moins exubérant et paraissait surveiller les alentours d'un œil mauvais.
Cette petite troupe n'inspirait guère de sentiments bienveillants, mais les billets jetés négligemment sur le comptoir devaient, aux yeux de Giani, compenser largement leur déficit de capital sympathie. Jusqu'au moment où, pour une raison inconnue si ce n'était celle de l'alcool, une dispute avait éclaté entre la femme et le petit nerveux. Celui-ci, à court d'injures, lui avait décoché un coup de poing en plein visage et commençait à la bourrer de coups de pieds alors qu'elle était tombée à terre. Steph, le barman, complètement affolé avait couru chercher du secours auprès du videur, Sami ; A quelques mètres de l'action, je n'avais pas esquissé un geste, si ce n'est une légère rotation sur mon siège pour me permettre une vision panoramique des protagonistes et de la salle.
Lorsque Sami était arrivé en courant pour intervenir, il avait été stoppé net dans son élan par un direct à la tempe porté par le gorille du trio qui s'était décalé sur le côté. Sami s'était effondré d'un seul coup, tombant sur les genoux avant de s'étaler lourdement, sans connaissance. Son agresseur n'avait pas eu le temps de savourer sa victoire : Giani que j'avais vu se glisser furtivement derrière le costaud lui avait flanqué un coup de matraque sur l'arrière du crâne ; Comme privé du support de ses jambes, il s'était affaissé avec une expectoration animale, K.O à son tour. L'hécatombe prenait des proportions intéressantes ! Le goujat violent, délaissant sa victime, s'était retourné pour faire face à Giani. Beaucoup plus jeune et rapide que le petit italien, il lui avait balancé un crochet qui l'avait atteint sur le côté du visage, lui faisant éclater une arcade sourcilière, avant de le plier en deux d'un uppercut au plexus. Malgré les fourmillements que je ressentais dans tout le corps et une certaine excitation malsaine qui montait, j'étais résolu à ne pas bouger. Mais la tournure des événements m'avait obligé à sortir de ma réserve. Giani, à quatre pattes, tentait de reprendre ses esprits. Je m'étais interposé entre lui et son adversaire, de toute évidence un boxeur comme son copain, à ce que j'avais pu en juger. La suite fut semblable aux nombreuses batailles livrées dans d'autres bars … Toute la technique du belliqueux n'avait pas pesé lourd et ne m'avait pas empêché de lui briser un bras. Je m'étais ainsi fait le plus fidèle des amis en la personne du très reconnaissant Giani.
~ * ~
Arrivé à Paris vingt-cinq ans plus tôt, Giani Mercuri, un italien courtaud et trapu, avait exercé le métier de pianiste de bar dans plusieurs établissements de Pigalle et tenté parallèlement de percer dans la chanson de variétés. Au milieu des années 70, il avait eu son heure de gloire. Le troisième des quatre 45 tours qu’il avait enregistré avait caracolé en tête des hit-parades pendant sept semaines. Le tube de l’été 1976, "mon cœur italien", destinait alors le jeune Giani à occuper durablement une place de choix dans le jardin secret des midinettes et à servir de modèle à tous les apprentis tombeurs boutonneux. Puis la vague disco déferlant sur l’Europe avait balayé les vendeurs de guimauve. Giani aurait sans doute pu, comme d’autres aussi peu talentueux, s’adapter en changeant de registre de niaiseries. Mais un événement tragique ne lui avait laissé aucune possibilité d’envisager une stratégie nouvelle et de réorienter ses plans de carrière. Giani avait séduit la femme d’un célèbre animateur de télévision. L'épouse volage avait quitté mari et enfants pour suivre en tournée la vedette plus jeune qu’elle d’au moins quinze ans. Lassé au bout de quelques jours, Giani avait purement et simplement renvoyé sa conquête, en lui offrant un billet de train pour rentrer à Paris. Déception, retour brutal à la réalité, honte…. La bourgeoise délaissée par son amant ne réintégra pas le domicile conjugal. Elle ne quitta même pas sa chambre d’hôtel où son cadavre fut trouvé le soir même de sa répudiation. Elle avait conclu à Toulouse cette médiocre et caricaturale "road story" en se tailladant les veines.
La presse toute entière se déchaîna alors contre Giani. Des magazines pour jeunes aux quotidiens généralistes, en passant bien évidemment par la presse à scandales, tous les journaux clouèrent au pilori la star ignominieuse. Ceux-là même qui naguère encensaient le "bourreau des cœurs" pour ses succès amoureux, crièrent haro sur un pervers dégénéré. Le mari bafoué, initialement résigné à son infortune, laissa libre cours à sa haine et à sa soif de vengeance. Il battit le rappel de ses relations influentes dans le monde du showbiz. Plus une seule émission de radio ou de télévision n’invita Giani. Sa maison de disques ne tarda pas à résilier son contrat. Giani crut tout d’abord à simple purgatoire. Il attendit la fin de sa traversée du désert en donnant de temps à autres quelques galas en province, dans des salles communales et des night-clubs de troisième ordre. Au bout de deux ans, il dut se rendre à l’évidence : sans aucun soutien promotionnel, il ne reprendrait jamais contact avec un public versatile qui l’avait déjà oublié. Giani avait alors réuni les quelques économies que son atavisme paysan lui avait dicté d’effectuer pendant sa période faste. Il avait ouvert cette boîte qu’il tenait toujours dans le quinzième arrondissement de Paris, rue de la Croix-Nivert : le Giani’s Bar. Sa notoriété passée n’avait pas été d’une grande utilité pour faire prospérer son affaire. Rares étaient les clients qui, jetant un regard distrait sur la vitrine dans le hall d’entrée mettant en valeur deux disques d’or et des photos de concerts, établissaient un lien entre une jeune gloire des temps révolus et le quinquagénaire maître des lieux. Mais les affaires étaient prospères, la boîte était le plus souvent pleine à craquer et Giani pouvait se permettre le luxe de refuser du monde à l'entrée. La clientèle était hétéroclite, de l'étudiant fils de famille à l'avocat play-boy en passant par l'acteur un peu voyou. Mais tous ceux qui fréquentaient le Giani's, avaient en commun de posséder un compte en banque confortable qu'ils allégeaient volontiers et très régulièrement dans l'établissement du latin lover recyclé.
~ * ~
Depuis l'incident, je passais au Giani's une ou deux heures chaque soir, de préférence en semaine parce qu'était plus calme, jusqu'à minuit environ. Il m'arrivait de m'y rendre également les vendredis et samedis, pendant mes périodes d'insomnie - et elles n'étaient pas si rares ! - mais plutôt peu avant la fermeture, vers trois heures et demie du matin lorsque la boîte commençait à se vider. Giani m'accueillait invariablement avec la même joie sincère :
- Benvenuto, amico mio ! Viens prendre un verre moi ! Alla tua salute !
Nous bavardions -ou plus exactement, Giani parlait et je l'écoutais - soit au comptoir, soit dans le petit bureau-salon situé juste derrière le bar. Outre qu'il se sentait mon débiteur pour l'aide que je lui avais apportée, Giani appréciait beaucoup ma compagnie. Nous avions en commun de ne pas boire d'alcool et cela semblait constituer une grande qualité à ses yeux. Nous trinquions au jus de fruits ou au soda. Il m'avait avoué en souriant malicieusement un de ses subterfuges :
- Avec mon métier, je ne peux pas refuser de boire avec les clients. Alors, je dis que je prends un whisky-coca. Et je ne verse que du coca dans mon verre. Ils ne voient pas la différence.
Il ne se formalisait pas de ma nature réservée et de ma réticence à me livrer. Il parlait pour deux avec sa faconde méditerranéenne et me racontait son passé de vedette de la chanson, me montrait des photos et des coupures de presse.
- Tiens ! Regarde, ça c'est une photo de moi sur la scène de l'Olympia.
Durant ce voyage dans le temps, ma mémoire m'entraînait dans d'autres directions…
A la date à laquelle avait été prise cette photo, je devais avoir quatorze ou quinze ans. Je vivais à Lyon, sous un autre nom, avec un père instituteur et une mère au foyer, parents attentionnés et dévoués à leur fils unique. Je fréquentais le très sérieux Lycée Edouard Herriot dont j'étais un des élèves les plus brillants. Après mon baccalauréat, qui n'aurait été sans aucun doute qu'une pure formalité, je comptais intégrer l'Ecole Normale Supérieure et me destiner à l'enseignement. J'aurais mené, parallèlement, une carrière d'historien en écrivant des ouvrages sur les guerres saintes, de la première croisade des "va-nu-pieds" à la prise de Jérusalem par les chrétiens en 1099, mon domaine et ma période d'études et d'investigations privilégiés.
En ce temps-là, mes rêves et mes projets me transportaient bien au-delà du lendemain…
Je connaissais cette photo. Je l'avais déjà vue, reproduite dans des magazines consacrés aux célébrités du spectacle auxquels ma mère était abonnée. Je connaissais aussi les chansons de Giani que ma mère passait en boucle sur sa platine. Me intérêts musicaux étaient radicalement différents. Bien qu'éclectiques, du rock à la musique classique, mes goûts n'incluaient pas ces mélodies sirupeuses, peut-être simplement par "snobisme", pour céder à un certain anticonformisme hautain et de bon aloi pour un garçon de mon âge. Je me moquais gentiment de ma mère lorsqu'elle fredonnait "mon cœur italien", le plus grand succès de son idole. C'était le prélude à de grands fous rires et à des moments de grande complicité. Oui ! Nous avions tous deux, Giani et moi, nos propres raisons d'éprouver de la nostalgie de cette époque. Mais j'avais, pour ma part, également des motifs de colère et de haine…
Giani me montrait aussi des photos de ses enfants dont il était très fier. Ils vivaient avec leur mère en Italie. Giani les faisaient venir à Paris chaque année pendant les vacances scolaires. Sur le sujet de sa progéniture, comme sur celui de sa gloire d'antan, Giani était intarissable. J'écoutais en acquiesçant poliment à ses paroles, mais au bout d'un moment je n'écoutais plus… Les souvenirs qui m'assaillaient, avec une acuité douloureuse, faisaient s'estomper les traits du fils de Giani pour leur superposer ceux d'un autre jeune homme qui, lui, avait très tôt perdu toute gaieté et ses illusions d'une vie heureuse.
Depuis plusieurs mois, mes parents se disputaient de plus en fréquemment. Même s'ils avaient fait tout leur possible pour éviter tout débordement lorsque j'étais là, je voyais leurs masques figés, les mâchoires crispées, les gestes nerveux, les silences pesants, autant de signes qui me renseignaient sur la scène qui s'était déroulée avant mon arrivée. Parfois, incapables de se maîtriser, ils se laissaient aller à des éclats de voix devant moi. Bien qu'aucun n'ait jugé utile d'avoir une discussion avec moi, les bribes de disputes dont j'avais été le témoin m'avaient suffisamment instruit sur la nature de leur conflit : Ma mère voyait un autre homme ! Cette révélation avait eu sur moi l'effet d'un tremblement de terre faisant s'écrouler l'édifice de mes certitudes.
Elle avait d'ailleurs quitté notre domicile, deux semaines auparavant. A mon réveil, mon père m'avait simplement dit, d'une voix lasse mais dure et sans autre commentaire :
- Ta mère est partie cette nuit. Elle ne reviendra pas.
Elle avait pourtant réintégré la maison, trois jours plus tard, sans davantage d'explications. Mais, à compter de ce jour, sans plus se soucier de ma présence, mon père ne se privait plus de lui asséner des remarques acerbes sur ses mœurs, son "maquereau" et autant d'injures auxquelles elle ne répondait presque plus, sinon par des larmes silencieuses.
J'avais, moi aussi, signifié ma réprobation à l'égard de ma mère, en observant une distance qui tranchait avec ce qui avait été, jusqu'alors, une proximité filiale voire une complicité amicale d'une rare intensité. Elle pleurait et je ne savais même pas si c'était parce qu'elle se sentait coupable ou brimée…
En cette fin d'après-midi du 11 décembre 1977, nous étions en voiture, mes parents et moi, sur la route nationale 201, en direction de l'autoroute A 43 pour rejoindre Lyon. J'ai refait, depuis, ce parcours maintes fois en esprit ! Nous avions passé ce dimanche à Chambéry, chez ma grand-mère paternelle. Mon père n'avait cessé de rabaisser ma mère devant ma grand-mère navrée qui avait tenté, sans grand succès, de dévier les conversations sur des sujets, sinon consensuels, du moins anodins. Sur le chemin du retour, il avait continué à l'agonir d'injures. Elle, demeurait muette. Mon père avait une légère déficience visuelle, ce qui l'amenait à céder le volant à ma mère, lors des trajets nocturnes. Elle conduisait donc, en subissant son monologue qui frisait l'hystérie haineuse. J'avais l'impression que c'était l'absence de répliques qui amenait la fureur de mon père à son paroxysme. Pendant les premiers kilomètres, à l'arrière du véhicule, j'ai appris les moindres détails de ce qu'il lui reprochait. J'ai assisté, au cours du plus violent des réquisitoires de mon père, en voyeur contraint et désespéré, à la mise à nu de l'intimité d'un couple. J'aurais voulu intervenir, supplier mon père de cesser, autant par pitié pour ma mère que pour m'épargner ce déballage d'une indécence tragique. Je n'ai pas osé.
Ce n'est que quelques minutes seulement après notre départ, alors que ma mère n'avait toujours pas prononcé un mot, que cela s'est produit. En pleine ligne droite, notre voiture s'est déportée sur la gauche. Le conducteur qui venait en face a lancé des appels de phares frénétiques. Mon père a saisi le volant pour tenter de rectifier la trajectoire. Je me souviens d'un choc effroyable, de la perte de tout repère dans l'espace, d'une grande douleur, du fracas des tôles écrasées et des cris, puis du silence et du néant…
~ * ~
Je me suis réveillé après dix-sept jours de coma. J'ai passé huit mois à l'hôpital, d'abord dans l'impossibilité de me lever, puis à suivre des séances de rééducation pour effacer les traces de mes multiples fractures. Je n'ai pas assisté à l'enterrement de mes parents, tués sur le coup dans l'accident.
A ma sortie de l'hôpital, j'étais allé vivre à Marseille, auprès de mes grands-parents maternels, un peu plus jeunes que ma grand-mère paternelle et, croyait-on, plus aptes à prendre en charge l'éducation d'un garçon traumatisé par la disparition brutale de ses parents. Je fus inscrit à l'Ecole Lacordaire, un établissement privé fondé par les pères dominicains à la fin de la première guerre mondiale et au moins aussi prestigieux que mon précédent lycée de Lyon. Je devais y reprendre mes études interrompues le temps de ma convalescence et présenter mon baccalauréat au terme de cette nouvelle année de scolarité. Mais l'élément prometteur que j'avais été appartenait à un passé irrémédiablement révolu. Plus rien ne m'intéressait, ni les matières enseignées, ni les perspectives d'études supérieures exaltantes ou d'une future carrière pleine d'honneur vers laquelle mes résultats passés me conduisaient… avant le drame.
En plus, cette école qui respirait le dévouement des enseignants et la garantie de la réussite, m'avait déplue d'emblée. A cause de ses deux devises : L'une, "Juventuti vertitas" (Il faut dire la vérité à la jeunesse) s'adressait aux professeurs de l'école ; l'autre, "Réussir pour servir" était à destination des élèves. J'avais reçu ces devises comme une double provocation qui m'aurait été personnellement adressée : Quelle vérité aurais-je pu attendre du monde des adultes et plus largement du genre humain ? Malgré tous mes efforts voués à satisfaire mes parents et mon entourage par mon attitude, mon travail, je n'avais été récompensé que par le spectacle indigne de la tromperie, de la trahison et du non-dit. Servir, réussir ? Réussir quoi, servir à quoi et qui ? A peine commencée, ma vie avait été brisée et, si je n'avais gardé aucune séquelle de mes blessures physiques, une faille insondable s'était ouverte en moi. Je revivais l'accident, de nuit comme de jour, crispant mes muscles dans l'imminence du choc qui me paraissait à chaque fois aussi réel que ce soir-là.
Je ne suis resté que deux mois à l'Ecole Lacordaire. J'étais devenu irascible et brutal. Plusieurs de mes condisciples en firent l'amère et douloureuse expérience, pour des motifs futiles. Je fus vite renvoyé et annonçais à mes grands-parents mon intention irrévocable d'arrêter définitivement mes études. Ils essayèrent mollement de me raisonner, sans trop insister, convaincus que l'indulgence et la compréhension étaient les seules réponses à apporter aux humeurs et aux caprices d'un adolescent déjà si cruellement meurtri.
~ * ~
Environ un an après avoir mis un terme à ma scolarité, le bilan de mes activités était édifiant. J'habitais toujours chez mes grands-parents, mais sans vraiment vivre "à leurs crochets". Je ne travaillais pas mais j'avais toujours de l'argent, dont ils préféraient ne pas me demander la provenance. Je ne la leur aurais pas révélée de toutes façons. D'ailleurs, je ne leur adressais pratiquement pas la parole. Je ne les croisais que lorsque je rentrais dormir et manger, à intervalles irréguliers. Je remarquais, sans m'émouvoir, leur façon de m'observer avec inquiétude. Il n'y avait aucun conflit entre nous. J'étais simplement indifférent à leur égard, comme je l'étais vis à vis de toute personne ou de tout événement. Quand ma grand-mère de Chambéry décéda, je ne manifestais aucune affliction à cette nouvelle, pas plus d'ailleurs que l'intention de me rendre à ses obsèques. Les filles ne m'intéressaient absolument pas, sauf pour satisfaire des besoins élémentaires. Je fréquentais les prostituées sans aucune gêne, préférant leurs services rétribués aux minauderies de petites amies de mon âge. Je n'envisageais pas non plus de liaisons avec des femmes plus âgées. J'étais devenu totalement insensible, excepté en ce concernait deux choses. La première était la douleur du cauchemar récurent de l'accident, que je faisais endormi ou éveillé et qui affouillait encore davantage la crevasse qui avait déchiré mon être. La seconde était le plaisir, au niveau de la jouissance, que j'éprouvais lorsque je me bagarrais, ce qui arrivait très souvent. Un rien déclenchait mon agressivité et ma violence : Une réflexion, un regard un peu trop appuyé que je me plaisais à interpréter comme un défi, une bousculade involontaire dans la file d'attente d'un cinéma… n'importe quoi était prétexte à assouvir mes penchants les plus bestiaux. Je ne pratiquais aucun sport de combat mais j'avais l'instinct du tueur et je ne connaissais pas la peur. Je frappais le premier, fort, pour détruire mon adversaire, quel que soit son gabarit, à poings nus, à coup de pieds ou avec tout ce qui me tombait sous la main. Je ne m'arrêtais qu'une fois mon adversaire, volontaire ou non, hors d'état de nuire, de préférence ensanglanté. Depuis longtemps, je me déplaçais armé d'un pistolet 9 mm que j'avais acheté dans un bar. Je ne m'en étais jamais servi, sinon pour l'essayer, en dehors de la ville dans une carrière désaffectée, mais la tentation était grande… L'occasion se présenta à la suite d'une embrouille avec un dealer du quartier des Aygalades. Je l'avais arnaqué, plus par jeu et goût du risque que motivé par l'appât du gain. Trois jours après ce coup, j'étais retourné aux Aygalades comme une fleur, sans la moindre appréhension. J'étais seul, car à la différence de la plupart des jeunes se livrant à des occupations illicites, je ne faisais partie d'aucune bande. Un véhicule au bord duquel avaient pris place mon concurrent revanchard et trois de ses comparses a ralenti à ma hauteur. Je n'ai eu que le temps de plonger derrière une voiture en stationnement pendant que des impacts de balles frappaient les carrosseries et le trottoir à quelques mètres de moi. En entendant la voiture accélérer, je suis sorti de mon abri et j'ai vidé mon chargeur sur les fuyards, sans les atteindre, puis j'ai rapidement quitté les lieux, sans attendre la police. Le lendemain, j'ai appris par une rumeur galopant dans les quartiers Nord de Marseille qu'un "contrat" avait été lancé contre moi. Tête brûlée, je savais néanmoins que cette pègre en herbe était aussi dangereuse que les vrais truands. C'est alors, que j'ai décidé, à dix-huit ans et demi, de devancer l'appel du service militaire. Un mois et demi plus tard, je me retrouvais incorporé dans la marine nationale, sur la presqu'île de Saint-Mandrier, en face de la rade de Toulon, hors de portée de mes ennemis, à soixante kilomètres de ces rats qui ne s'aventuraient pas si loin au-delà des limites de leur territoire.
~ * ~
Curieusement, je m'étais accommodé assez facilement de la discipline en vigueur sur la base navale. J'avais réservé mes défoulements violents à mes sorties dans la basse-ville de Toulon, "assainie" depuis mais qui constituait alors la zone "chaude" comprise entre les rues Victor Micholet et Pierre Semard, communément dénommée Chicago à cause de la profusion de bars louches et de la densité de sa population de prostituées. J'étais devenu plus prudent, je sortais accompagné par d'autres marins, non pour me prêter main forte dans les rixes, mais pour surveiller mes arrières, car les coups de couteau, de rasoir ou de cutter donnés en traître étaient monnaie courante dans les parages. Je prenais soin de m'esquiver avant l'arrivée des flics ou des patrouilles de la police maritime. J'avais menacé mes compagnons des pires représailles si des échos de ces bagarres, qui laissaient quelquefois des types sérieusement démolis, parvenaient aux oreilles des autorités navales. Ainsi, effectuant un service irréprochable, j'étais bien noté et j'avais même été désigné chauffeur de l'Amiral.
Peu avant ma "quille", je croisais un type de Marseille que je connaissais de vue et qui venait de s'engager. Il m'apprit que mon "vieux copain", le dealer des Aygalades savait où je me trouvais et qu'il ne m'avait pas oublié. Il claironnait à qui voulait l'écouter qu'il m'avait fait faire dans mon froc, que je m'étais sauvé comme une gonzesse, que j'étais tricard à Marseille et que si l'idée stupide me prenait d'y revenir, ce serait ma toute dernière visite. Une rage meurtrière m'avait envahi et le messager de cette information humiliante ne dut qu'à notre présence en uniformes dans l'enceinte de la base, de ne pas en faire les frais. Je sus me contrôler, en attendant ma libération de mes obligations militaires pour régler mes comptes.
~ * ~
Le matin même de mon retour à la vie civile, je me rendis dans l'agence bancaire toulonnaise où j'avais fait transférer mon compte marseillais, confortablement garni du fruit de mes activités passées. Je retirais tout l'argent et allais m'enquérir d'une arme à acheter dans un bar de Chicago - certains bars sont souvent aussi bien achalandés que les armureries et beaucoup plus discrètes ! - Je fis affaire rapidement, en réglant le prix fort sans discuter et pris le premier train pour Marseille, un P 38 en poche. J'arrivais à la Gare Saint-Charles vers 13 heures et, sans rendre visite à mes grands-parents que je n'avais pas vus depuis mon repli stratégique de la cité phocéenne, je sautais dans un taxi pour me rendre aux Aygalades. Parvenu dans le hall de l'immeuble où habitait, un an auparavant, celui qui m'avait soi-disant terrorisé, j'inspectais les boites aux lettres déglinguées. Sur l'une d'elles, je déchiffrais une inscription : Mohamed Ali Ben El Hadj - C64.C'était le père de cette ordure. Par précaution, je pris soin d'effectuer une seconde vérification en hélant un môme de dix ou onze ans qui me regardait d'un air effronté:
- Hé ! Je cherche un copain, Djamel Ali Ben El Hadj. Il habite toujours ici ?
- Ouais ! C'est au sixième.
- Tu sais s'il est là ?
Le gamin prit un air offusqué en bombant le torse :
- Ho ! chuis pas l'concierge ! T'as qu'à aller voir, quoi !
Mais, ne pouvant réprimer l'envie de me démontrer que rien ne lui échappait et qu'il savait tout ce qui se passait dans son immeuble, il ajouta :
- A c't'heure-là, il est toujours là. Il sort qu'après 6 heures du soir, quoi ! Hé t'as une cigarette ?
- Non.
- Ah ! Bouffon va !
Sans répondre, j'entrais dans l'ascenseur puant et couvert de graffitis obscènes qui me déposa au sixième étage.
L'appartement 64 était sur la gauche. Je sortis le revolver de ma ceinture et frappais à la porte. Une voix de femme se fit entendre derrière la porte restée close :
- C'est qui ?
- J'appartiens aux services techniques municipaux, Madame. Je viens recenser les appartements à repeindre.
- On n'a pas besoin. On pas l'argent pour la peinture.
- Vous n'aurez rien à payer, Madame. C'est gratuit. Mais je suis obligé de voir l'appartement d'abord, sinon ce sera à votre charge. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît ?
Après quelques secondes pendant lesquelles elle sembla hésiter, je l'entendis actionner le verrou en maugréant et la porte s'entrouvrit pour laisser apparaître un visage méfiant et bouffi surmonté d'un foulard. Sans lui laisser la possibilité de me détailler, je balançais un grand coup de pied dans le battant qui la percuta violemment. J'entrais rapidement en refermant derrière moi. La grosse fatma tentait de se relever péniblement, vociférant en arabe, ce que je devinais être des injures. Son nez qui laissait échapper deux coulées de sang avait pris des proportions monstrueuses. Sans m'arrêter, je lui assénais un phénoménal coup de crosse au passage, mettant fin à ses glapissements en l'assommant. Tenant le P 38 à bout de bras devant moi, j'ouvris une à une les portes que je rencontrais dans ma progression. Toutes les pièces étaient vides, sauf la dernière, une chambre où mon "cher camarade" Djamel, visiblement réveillé par le vacarme, était en train de passer un pantalon dont il n'avait enfilé qu'une jambe. En apercevant le revolver, il leva les mains et son pantalon retomba à terre. Le grotesque de la scène et la satisfaction de vivre enfin ce moment que j'attendais depuis la seconde où j'avais appris ce que cette enflure disait de moi, m'arrachèrent un sourire.
- Bonjour Djamel. Ça te fait plaisir de me voir ?
- Hé fais pas le con, mec !
- Moi, faire le con ? Mais, c'est toi qui as l'air d'un con, Djamel, en caleçon avec ton futal sur les orteils !
Les cris de la mère de Djamel avait dû alerter les voisins. Je n'avais pas trop de temps pour savourer ma revanche. J'inclinais mon arme et lui logeais une balle dans le genou gauche. Djamel s'effondra en hurlant.
- Tu diras à tes potes que c'est une gonzesse qui fait dans son froc qui t'a explosé une guibole, connard !
Je l'ai contemplé quelques secondes en appréciant de le voir se tortiller par terre, comme un ver de terre, en pressant à deux mains la bouillie sanglante de son genou. J'aurais voulu que toutes les cloches qui avaient pu croire que j'avais peur de ce minable puissent le voir aussi et l'entendre couiner comme un cochon qu'on égorge. Enfin contenté, je fis demi-tour, j'enjambais la mère toujours étendue sans connaissance dans l'entrée et je sortis de l'appartement. Comme je m'y attendais, les cris et surtout la détonation, avaient attiré les curieux qui s'agglutinaient dans le couloir. En voyant le revolver que j'avais gardé au poing, ce fut une envolée de moineaux. Les portes et les verrous claquèrent et, en un éclair, le couloir redevint désert. Sans précipitation, je descendis par l'escalier pour éviter le risque d'être coincé dans l'ascenseur pour une raison quelconque et quittais l'immeuble sans être inquiété. J'étais dans un état proche de l'ivresse. Mais, une partie de mon cerveau conservait assez de lucidité pour savoir que le plus difficile restait à entreprendre.
A Toulon, alors que je tournais et retournais dans ma tête le scénario de mes retrouvailles avec Djamel, j'avais appris que celui-ci était passé du stade de petit dealer à la catégorie supérieure, en se mettant au service de "gros calibres" du milieu marseillais. Il n'était certainement qu'un larbin de troisième ordre de ces caïds, mais personne ne s'était jamais attaqué impunément à un des leurs, sauf les flics bien sûr. Il me fallait donc, une nouvelle fois, chercher des horizons plus hospitaliers. Peu m'importait ! Le flot d'adrénaline qui m'avait procuré cette incomparable extase valait bien un exil !
~ * ~
Après mon expédition punitive, j'avais pris la décision de visiter d'autres paysages. Je m'étais planqué pendant une semaine à Nice, dans un petit hôtel. En épluchant les journaux régionaux, j'avais appris que le plus grave n'était pas d'avoir estropié Djamel. Il y avait pire : Sa vieille n'avait pas bien digéré le coup sur la tête et elle avait tellement été contrariée par sa fracture du crâne qu'elle en était restée comme un légume ! Ce n'était plus seulement la mafia marseillaise que je devais redouter, mais aussi la police qui était à ma recherche. Je m'étais alors débrouillé pour passer en Italie, clandestinement puisque la convention de Schengen permettant la libre circulation des ressortissants de la Communauté Européenne entre les états membres n'existait pas encore. Après six mois à vivoter dans la plus grande discrétion possible à Gênes, je pris une autre décision qui allait m'engager une grande partie de ma vie. Je repassais la frontière, dans les mêmes conditions, pour revenir à Nice où je me présentais à la caserne Filley, rue Sincaire, centre de recrutement de la Légion Etrangère.
Muni d'une nouvelle identité - privilège offert par la Légion aux candidats ayant quelques démêlés avec la justice- et après un passage de quatre mois par les centres de formation d'Aubagne et de Catelnaudary comme toutes les nouvelles recrues, je fus affecté au 1er Régiment Etranger de Cavalerie basé à Orange. Avec le 1 REC, je fus présent sur divers théâtre d'opérations : A Beyrouth en 1983, puis au Moyen Orient dans le cadre de l'opération Daguet pendant la guerre du Golf, au Cambodge ensuite, à plusieurs reprises sous l'égide de l'ONU et enfin en Bosnie-Herzégovine, sans compter plusieurs missions en République Centrafricaine, au Tchad et ailleurs en Afrique, en Asie et dans l'Océan Indien.
Cette vie aventureuse me plaisait. Je dus forcer ma nature solitaire pour adopter, du moins en apparence, l'esprit de solidarité qui régnait dans la Légion. Mais en réalité, l'effort fut minime. Si j'ai jamais eu des amis depuis mon adolescence, ce fut sans aucun doute à la Légion. Une des caractéristiques de cette armée était de favoriser la vie en autarcie, aussi favorisait-elle la vie familiale, par les multiples et diverses installations de ses camps : magasins, restaurants, salles de sports, de détente et de rencontres. J'aurais donc pu, en prenant compagne ou épouse, recréer une famille en remplacement de celle avec laquelle j'avais rompu tout lien et rejetée dans le passé. Mais j'avais conservé mes habitudes en n'ayant de relations qu'avec des prostituées, comme nombre d'autres légionnaires d'ailleurs, mariés ou non. Quant à mes accès de violence, ils se manifestèrent à plusieurs reprises, mais moins souvent qu'à Marseille. Les bagarres auxquelles je pris part, avec le même plaisir, se déroulèrent dans le cadre de sorties collectives dans des bars. La férocité dont je fis preuve en ces occasions me valurent d'être craint et respecté de mes camarades, y compris des plus gradés que moi. On était loin des valeurs du Lycée Edouard Herriot ou de l'Ecole Lacordaire ! Les légionnaires qui provoquaient ces affrontements ou répondaient à des provocations de civils, étaient toujours fortement imbibés. Pour ma part, je ne touchais jamais une goutte d'alcool. Il y avait une raison précise à ma tempérance inflexible: je ne voulais pas me laisser aller, dans un moment d'ivrognerie, à m'épancher auprès d'un de mes camarades sur le cauchemar qui continuait de me hanter, jour après jour, nuit après nuit, celui d'un certain trajet automobile Chambéry-Lyon, voyage qui n'atteignit jamais son but mais dont je revivais chaque seconde, entendais à nouveau chaque parole prononcée par mon père ainsi que tous les bruits de l'accident, et ressentais surtout les mêmes émotions demeurées intactes…
~ * ~
Après dix-huit années passées dans la Légion, parvenu au grade de lieutenant, j'aurais pu poursuivre cette carrière pendant au moins aussi longtemps. Mes états de service étaient excellents, ma brutalité au-dessus des normes qu'avaient repéré mes officiers supérieurs ne constituait pas une tare inadmissible à leurs yeux ; Mes grands-parents que je n'avais jamais revus devaient être morts depuis longtemps ; j'étais célibataire, personne ne m'attendait hors des murs de ma caserne… Cependant, un matin, je m'étais réveillé avec l'irrépressible envie de partir et de changer de vie. La décision fut instantanée. Mon colonel, après un entretien visant à vérifier que cette décision subite n'était pas due à un état d'âme passager ou un mouvement d'humeur que je serais amené à regretter, me dirigea sur le bureau de réinsertion de la Légion. Cette structure, qui soutenait les légionnaires lors de leur retour à la vie civile, me mit en rapport avec un ancien officier qui avait ouvert une société de gardiennage et de transport de fonds à Paris. Deux mois plus tard, j'étais chargé de la gestion des équipes de surveillance de grandes surfaces parisiennes. Le patron, l'ex-capitaine Laigle, m'avait même trouvé une location dans le XV ième arrondissement.
Un soir, je revenais en métro de la rue Saint-Denis où j'étais allé satisfaire avec une prostituée mon seul besoin de compagnie féminine. En quittant la station Cambronne, je me dirigeais vers mon appartement de la rue du Théâtre, en suivant la rue de la Croix-Nivert. Une fois de plus, une de mes impulsions me commanda de m'arrêter au Giani's pour passer un moment avant de rentrer. A l'entrée, le portier en chemise blanche et nœud papillon me jaugea d'un œil qui se voulait expert avant de m'ouvrir la porte.
C'était un soir de semaine. Il n'y avait qu'une vingtaine de clients dans la boîte. Deux couples dansaient sur la piste. Quelques tables, à proximité du bar, étaient vides, le reste des noctambules préférant la pénombre des boxes accolés à trois des murs de la salle. Je me suis installé sur un des tabourets du bar et j'ai commandé un cocktail de jus de fruits.
Derrière le comptoir, un homme houspillait le jeune barman avec de grands gestes en ponctuant sa diatribe d'exclamations en italien et d'un tic nerveux qui lui faisait remonter ses lunettes sur son nez :
- Je t'avais dit trois caisses de champagne, pas deux. Razza di cretino ! Je ne peux pas te demander de réceptionner une livraison ? Et si je tombe malade ? Qu'est-ce que je fais ? Je ferme la boîte et je vous mets au chômage ? Disgrazia !
L'employé, visiblement habitué à ce numéro, demeurait totalement impavide. Il attendit que l'autre se taise pour répliquer calmement :
- Ce sont les livreurs qui se sont trompés. Ils apporteront la troisième caisse demain.
- Ma qué domani ? Demain, tu es foutu à la porte !
Le barman haussa les épaules. Il devait être viré tous les soirs…
La scène était amusante, mais je n'allais pas y passer la nuit ! Je m'apprêtais à partir sans finir mon verre quand mon regard fut attiré par une photo, face à moi, au-dessus des deux comiques. La photo d'un personnage vêtu d'un extravagant costume blanc à paillettes, une chemise ouverte à partir de la taille sur un torse velu, un pantalon à pattes d'éléphant et une coupe de cheveux mi-longue, une panoplie comme on en voyait plus depuis plus de vingt ans.
J'ai attendu que le ronchon disparaisse par une porte derrière le bar pour appeler le barman :
- Dites-moi, cette photo… Qui est-ce ?
- Le patron, Giani Mercuri, quand il était chanteur. C'était au temps des dinosaures. C'est la première fois que vous venez ici, sinon vous sauriez. Il oblige même le DJ à passer une de ses chansons pendant les slows, "mon cœur italien". Là-bas aussi il y a plein d'autres photos, dit-il en désignant le mur près de l'entrée qui était décoré d'images de l'ancienne vedette et de disques d'or. Je n'y avais pas prêté attention en entrant. Je suis allé voir de plus près. Et je suis remonté, très loin, dans le temps des dinosaures comme disait ce gamin de vingt ans. Je n'avais pas reconnu le petit italien braillard, mais je reconnaissais sur les photos la star que j'entendais si souvent chanter dans mes cauchemars…
C'est ainsi que le hasard, le destin ou la volonté d'un être supérieur sournois et manipulateur m'avait mis en présence d'un homme que je n'avais jamais rencontré auparavant, mais qui avait pesé si lourdement sur mon existence.
~ * ~
D'après ce qu'il m'avait dit, Giani ne sortait pratiquement jamais de son appartement situé juste au-dessus de la boîte, auquel il accédait directement par un escalier intérieur à partir de son bureau. Son ménage et ses courses étaient assurés par une dame qui venait l'après-midi. Ne voyant ses enfants qu'une fois par an, il devait se sentir assez seul, malgré son immersion totale dans son commerce. Giani avait trouvé en moi le confident parfait, toujours disponible et qui lui permettait de rompre sa solitude.
C'est tout naturellement qu'il s'ouvrit à moi d'un grave problème qui le préoccupait. Il était victime d'un racket de la part d'un gang de banlieue qui tentait d'étendre ses activités sur la capitale. Giani avait d'abord refusé de payer. Une voiture stationnée devant la boîte avait été incendiée à l'aide d'un engin artisanal. Giani, pour éviter toute mauvaise publicité, avait préféré ne livrer aucune information à la police qui l'avait interrogé, comme les autres résidents du secteur. Aucun lien n'avait donc pu être officiellement établi entre son établissement et cet acte de vandalisme, mais Giani avait parfaitement interprété l'avertissement. Le lendemain, les deux jeunes de Seine-Saint-Denis qui lui avaient déjà rendu visite revinrent encaisser sans difficulté le premier versement, conséquent, en proportion des importantes recettes du Giani's. Pourtant, il n'avait pas capitulé. Il n'avait cherché qu'à gagner du temps, en attendant de trouver la riposte appropriée. J'avais eu l'occasion de constater que Giani ne se laissait pas facilement impressionner, qu'il ne faisait pas dans la dentelle et ne rechignait pas, si besoin était, à manier la matraque avec détermination. Aussi, je ne fus absolument pas surpris lorsque, à quelques jours de la seconde échéance, il m'expliqua ce qu'il avait prévu : tout simplement dérouiller les envoyés de ses maîtres chanteurs pour leur transmettre, à son tour, un message clair et définitif signifiant son refus de céder à tout chantage. Je compris également que Giani ne m'avait pas mis dans le secret pour s'épancher, mais pour solliciter mon concours, de manière implicite. Je lui offrit mon aide sans l'ombre d'une hésitation. Nous avions mis au point les détails de l'opération sur l'instant. Giani proposait de faire appel à deux de ses amis italiens qui n'avaient pas froid aux yeux. Je repoussais cette proposition, l'assurant que je préférais m'occuper seul avec lui de cette affaire. Le videur et le barman étaient au courant du racket, mais compte tenu de l'inefficacité dont ils avaient fait preuve lors de la bagarre avec les deux boxeurs, leur participation ne fut même pas envisagée, ce qui m'arrangeait. Je sus me montrer suffisamment persuasif et habile pour que Giani retienne mes suggestions et soit convaincu, finalement, que le plan arrêté était le sien. Nous avions convenu qu'il conduirait les extorqueurs dans son bureau pour, en théorie, leur remettre l'argent. Je devais me trouver dans cette pièce en étant passé par son appartement, non par le night-club. Nous devions tous les deux être armés de pistolets. Ils devaient être chargés pour parer à toute éventualité, mais nous ne devions normalement pas nous en servir autrement que pour, dans un premier temps, intimider nos visiteurs dont nous ignorions encore le nombre. En revanche, nous devions utiliser de courtes matraques plombées et gainées de caoutchouc, pour une tabassée en règle. Giani possédait les armes nécessaires et, fort de ma collaboration, il était certain de disposer des arguments les plus imparables à opposer à ces figli di puta.
~ * ~
Il était minuit et demi. Je patientais, depuis deux heures, dans le bureau de Giani, d'où je pouvais observer le bar, l'entrée et la majeure partie de la salle sur une console composée de trois écrans relayant les images des caméras de surveillance de la boîte. Je voyais Steph, assisté en cette nuit de week-end par un autre barman et deux serveuses pour faire face à l'affluence, jongler avec verres et bouteilles à un rythme effréné. Sami ouvrait et refermait la porte d'entrée à une cadence soutenue, accueillant les arrivants avec indifférence, déférence ou un regard inquisiteur voire inhospitalier, selon le rang qu'il leur attribuait sur son échelle personnelle de valeurs, de la personnalité bienvenue à l'indésirable à refouler, poliment mais fermement. Ni Steph, ni Sami et encore moins Kamel le DJ ou les autres membres du personnel n'étaient avertis de ma présence. Giani se tenait entre le bar et l'entrée, saluant amicalement les habitués, comme à l'accoutumée, sans rien laisser paraître d'une éventuelle appréhension de ce qui était prévu par la suite. La veille, il avait reçu un appel téléphonique le prévenant que la somme serait récupérée le lendemain.
Vers une heure et quart, j'ai immédiatement su que les hommes que nous attendions venaient d'arriver. Ils étaient deux, entre vingt et vingt-cinq ans. Habillés élégamment, rien ne les distinguait particulièrement des autres noceurs, si ce n'était qu'ils avaient l'air d'être là pour n'importe quoi, sauf pour s'amuser. Ils se sont dirigés directement vers Giani et après un bref échange de paroles, sans s'être serré la main, ils l'ont suivi jusqu'au bar. Giani a fait signe à Steph de leur servir à boire, puis il est venu me rejoindre.
- Ça y est, ils sont là.
- Oui j'ai vu.
- Tu es prêt ? Tu as le pistolet ? La matraque ?
- Je suis prêt. Ne t'inquiète pas. Vas les chercher.
- Je ne suis pas inquiet. Je vais les massacrer ces petites ordures !
- Reste calme. Vas-y maintenant. Dis à Steph que tu es en rendez-vous et qu'il ne te dérange pas. Et n'oublie pas de pousser le verrou en revenant.
- OK, j'y vais.
Je suis allé me dissimuler dans la petite salle d'eau attenante au bureau, laissant la porte à peine entrouverte. Je les ai entendus entrer et Giani dire :
- Asseyez-vous.
Après quelques secondes, j'ai écarté doucement le battant. Les deux types me tournaient le dos, assis face à Giani qui était demeuré debout derrière sa table de travail. J'ai sorti mon pistolet, ouvert complètement la porte et je me suis avancé sans bruit vers eux. Celui qui paraissait être le chef du tandem s'est adressé à Giani :
- C'est pas qu'on s'ennuie chez toi, mais on est pressés. Alors tu nous files le fric et on y va. On a du TAF ailleurs.
- Si, si. Voilà.
Peut-être alerté par un coup d'œil de Giani dans ma direction, son comparse s'est retourné et m'a aperçu. Trop tard ! J'étais déjà sur lui et j'ai coupé ses velléités de se lever d'un bond en le giflant du canon de mon arme, lui éclatant une pommette. Il est retombé lourdement sur son siège, avec une plainte déchirante en se tenant le visage à deux mains. Dans le même temps, Giani avait lui aussi brandi son pistolet et menaçait l'autre qui avait spontanément levé les bras en signe de bonne volonté. Après que j'ai délesté nos prisonniers de leurs armes, Giani a rangé la sienne dans sa ceinture pour se saisir de sa matraque, s'est approché de l'encaisseur et, sans préambule, s'est mis à le frapper méthodiquement avec une force inouïe sur la tête et sur les bras qui tentèrent brièvement de constituer une protection peu efficace. Je suis allé prendre la place de Giani derrière le bureau, en maintenant toujours celui que j'avais amoché sous la menace de mon pistolet. Il avait perdu son allure de caïd. Il était terrifié par la scène qui se déroulait à un mètre de lui : son copain roué de coups, après avoir hurlé de peur et de douleur, supplié, avait essayé de s'enfuir ; Rattrapé par Giani qui avait redoublé de violence, il s'était recroquevillé par terre et ne laissait plus échapper que quelques grognements à peine audibles, à chaque coup porté. L'insonorisation totale de la pièce ajoutée au niveau sonore de la musique de l'autre côté de la porte ne laissait aucun espoir de secours au supplicié. Au bout d'un long moment, Giani s'interrompit, haletant, rougi par l'effort et les yeux hagards et m'interpella avec un sourire sadique :
- Tu t'occupes du tien ou tu me laisses ta part ? Remarque, il ne faut pas trop l'abîmer pour qu'il puisse nous débarrasser de celui-là à la fermeture !
- Non, je prends ma part. Toute ma part ! Ajoutai-je en logeant une balle dans la tête de celui qui m'était réservé avant de tirer par deux fois, dans la foulée, sur le corps inerte allongé sur le sol.
Giani, bouche bée, incrédule, a regardé tour à tour les deux corps avant de me demander d'une voix étranglée, sans réaliser dans son trouble qu'il me parlait en italien :
- Ma cosa stai facendo ? Sei pazzo ! (Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es fou !)
Sa stupéfaction ne fut pas moindre, lorsque je pris l'une des deux armes saisies sur les racketteurs pour la pointer sur lui.
- Voilà la conclusion, Giani. Un patron de night-club et deux voyous s'entre-tuent.
- Ma perqué ? Tu es mon ami ! Pourquoi tu fais ça ?
- Ma mère s'appelait Nicole Mathès.
Giani me regardait d'un air méfiant, essayant visiblement de mettre un visage sur ce nom.
- Tu ne te rappelle pas Giani ? Lyon ! Elle a été ta maîtresse, il y a plus de vingt ans. Elle a quitté sa famille, m'a abandonné, moi son fils, pour partir vivre avec toi. Quand elle t'a rejoint à Paris, tu l'as rejetée comme la dernière des putes. Et tu as fait pire : Tu as téléphoné à mon père pour lui dire que tu lui rendais sa femme et qu'il pouvait se la garder.
- Non, je ne me souviens pas ! Mais Enfin ! Si c'est bien de moi dont il s'agit, c'était il y a vingt ans ! Tu ne vas pas faire de connerie pour ça, vingt ans après.
- Attends, Giani ! Ce n'est pas tout. Le cocu a effectivement récupéré sa femme. Il lui a fait vivre un enfer. Alors, ça en plus des remords de ce qu'elle avait fait ou des regrets de t'avoir perdu… Va savoir… Elle a jeté sa voiture contre un camion qui venait en face. Complètement insensible au fait que sa famille se trouvait à bord de cette voiture. Mes parents sont morts à cause de toi. Ma mère a voulu me tuer à cause de toi. Tu comprends, Giani ?
Non ! Je voyais bien qu'il ne comprenait pas et surtout qu'il s'en foutait ! Il n'y avait même pas de peur chez lui, plutôt de la colère en écoutant cette histoire ridicule, concernant une femme qu'il avait renvoyée à son anonymat et dans l'oubli, comme tant d'autres.
- Tu ne peux pas faire ça ! Tu ne t'en sortirais pas !
J'ai soupiré. Je n'avais plus envie de lui parler, de lui expliquer tout ce que j'avais prévu de faire pour maquiller le triple crime en règlement de comptes sans survivant, avant de repartir par son appartement et de ressortir par la rue parallèle à celle de la boîte. Même si j'étais interrogé par la police, en tant de familier de Giani, personne ne pourrait prouver ma présence sur les lieux. Et quand bien même ! J'étais prêt à tout sacrifier, ma vie et ma liberté pour me décharger de mon fardeau !
A cause de cet homme, l'attitude de ma mère - son crime !- m'avait amené à éprouver un ressentiment contre toutes les femmes, presque de la répulsion, parce que j'avais été déçu, trahi par la seule que j'avais aimée. J'étais devenu pire qu'un misanthrope, un sauvage en voulant au genre humain entier. Ma vengeance avait un goût de miel car, derrière ce délice violent, je sentais poindre l'apaisement de mon âme et de mon cœur que j'avais tant espéré, depuis si longtemps. J'ai tiré. C'était fini. J'allais enfin pouvoir pardonner à ma mère et l'aimer comme avant.