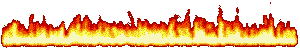Antoine KEVISA

Vous désirez lui laisser un mot sur
son LIVRE D'OR ?
Cliquez sur la photo !
..............................Son
site : .... .........................Son
mail :.
.........................Son
mail :.![]() ....
....
.......................................................
le café des poètes......................................
Page 1 - Nouvelles
SOMMAIRE
La malédiction du vendredi matin
Le grain de sable
Joyeuse fête
Un sale type
Une si jolie mélodie
La malédiction du vendredi matin
Le Docteur Francis Kamesese Ravalavaku s’arrachait les cheveux. Un an plus tôt, il avait vécu sa nomination comme Directeur Général du Horaniviki Memorial Hospital de Suva, comme la consécration de sa jeune carrière. A trente neuf ans seulement, le Docteur Ravalavaku était devenu un personnage important de l’establishment fidjien. Bien sûr, il savait pertinemment que sa promotion à ce poste devait beaucoup au ministre de la santé, Sir Abraham Sitivini Sovilomu, son oncle… mais il était surtout convaincu que ses compétences professionnelles et sa personnalité méritaient amplement ce petit coup de pouce qui n’avait fait que lui rendre justice ! Aux commandes du plus grand hôpital de Fidji, le Docteur Ravalavaku avait débuté sa mission sous les meilleures auspices : ayant reçu carte blanche de la Direction Générale de la Santé et du Conseil d’Administration du Horanaviki, il avait pu mener à sa guise les réformes qu’il estimait indispensables afin, dans le même temps, de moderniser son établissement et de procéder à des économies de bonne gestion dans ces temps d’austérité décrétés par le Gouvernement. Les politiques, les syndicats, les personnels soignants, administratifs et techniques… il avait habilement su mettre tout le monde dans sa poche sans voir se manifester la moindre réticence. Par des départs à la retraite anticipée non compensés, des réductions d’horaires des agents d’entretien et le recours à des entreprises privées sous-traitantes moins coûteuses que des fonctionnaires, et une guerre sans merci à tous les gaspillages de fournitures, le Docteur Ravalavaku avait su réduire les dépenses de fonctionnement de manière drastique et spectaculaire. Il avait pu ainsi dégager les moyens financiers pour acquérir du matériel médical neuf. Diplomate persuasif, il avait su convaincre le conseil d’administration et le ministère d’acheter de l’appareillage australien à la place de l’américain qui avait initialement été retenu par la commission d’appels d’offres officiant sous la houlette de l’ancien directeur. Le choix qu’il avait finalement imposé entraînerait un surcoût assez conséquent à l’achat, mais des frais de maintenance nettement diminués, pour une technologie équivalente. Tout avait donc souri au Directeur Général Ravalavaku durant les premiers mois qui suivirent son entrée en fonction. Mais aujourd’hui, il vivait un véritable calvaire !
Depuis quinze semaines, une mystérieuse épidémie, pire, une malédiction, s’était abattue sur le service de réanimation du Horaniviki ! Pendant cette période, vingt-quatre patients étaient décédés inexplicablement dans cette unité. En réalité, davantage, mais vingt-quatre… pour les seuls vendredis matins! Cette singulière régularité de perte de malades chaque vendredi –et toujours le matin !- défiait toute logique. Cette consternante série noire ne pouvait en aucun cas être simplement considérée comme telle ! L’Inspection Générale du Ministère de la Santé avait eu vent de la rumeur de «malédiction» qui s’était répandue au sein et en dehors du Horaniviki et avait diligenté une enquête administrative que le Docteur n’avait pu empêcher.
Les investigations toujours en cours n’avaient pas encore élucidé le mystère de « la malédiction du vendredi », comme le Fijian Inquirer avait baptisé l’affaire, appellation reprise par les autres quotidiens et l’ensemble des médias nationaux. Le Docteur Ravalavaku lui-même avait épluché méticuleusement les comptes-rendus de chaque acte médical concernant un patient décédé un vendredi… Rien d’anormal, aucune faute ne pouvait a priori être imputée aux médecins étant intervenus. Le matériel d’assistance respiratoire avait également fait l’objet d’un contrôle technique approfondi, sans qu’aucune explication plausible ne se dégage. Et pendant ce temps, chaque samedi, le Fijian Inquirer consacrait sa une et une pleine page intérieure au dernier épisode de la veille venant alourdir « la malédiction du vendredi »…
Les Fidjiens, comme de nombreux peuples du Pacifique Sud et particulièrement de la Mélanésie, étaient enclins à croire à la sorcellerie, aux maléfices et autres phénomènes surnaturels, mais nonobstant ces croyances ancestrales, l’affaire avait inévitablement glissé du champ administratif dans le domaine judiciaire afin d’explorer la piste criminelle. La plupart des familles des victimes du vendredi avait déposé plainte, se constituant partie civile.
Certains parents étaient animés par le seul souci de la vérité, d’autres par la cupidité qui leur faisait supputer une juteuse réparation financière. L’entrée de la salle des soins intensifs où s’étaient produits tous les décès suspects était gardée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un policier ; un médecin et une infirmière désignés par l’Inspection Générale de la Santé accompagnaient les médecins et les infirmiers du service de réanimation, afin de vérifier la conformité de tous leurs actes ; une seconde expertise du matériel avait été ordonnée… Ainsi contrôlés, espionnés, le personnel du Horaniviki cédait peu à peu à l’exaspération et à la paranoïa ; les patients eux-mêmes gagnés par la psychose et peu désireux de risquer « la malédiction » avaient déserté le Horaniviki en faveur d’autres hôpitaux, moins prestigieux mais assurément plus sûrs ! Que ce soit les vendredis ou les autres jours, la fréquentation du Horaniviki avait baissé de soixante pour cent !Le Docteur Ravalavaku dépérissait. Il avait perdu sommeil et appétit et se sentait au bord de la dépression. La semaine précédente, il s’était rendu à la réunion hebdomadaire de son club, dans un salon du Berjaya Hotel. Lui, d’ordinaire si à l’aise parmi cet aréopage de notabilités, d’hommes d’affaires, d’officiers supérieurs, de hauts-fonctionnaires et d’hommes politiques, s’était pour la première fois senti comme un pestiféré. Les regards fuyaient le sien pendant qu’il devinait les messes basses derrière son dos… Lui qui naguère rêvait de toutes les gloires, de succéder un jour à son oncle au ministère et peut-être plus… Il savait bien que son avenir si prometteur était en passe de devenir un vieux souvenir ! Mais une chose l’inquiétait plus que tout : l’administration et la police qui s’entêtaient à explorer la piste du défaut technique de l'équipement médical, en plus des autres hypothèses, risquaient de découvrir la raison pour laquelle il avait déployé tant de zèle à imposer ce matériel qui n’avait pourtant pas convaincu son prédécesseur. Peut-être découvrirait-on qu’un million de dollars australiens avaient été versés sur un compte ouvert à son nom dans une banque de Port-Vila, la capitale de ce nouveau paradis fiscal qu’était devenu le Vanuatu…
Le Docteur Ravalavaku, résigné, n’attendait plus que le coup de grâce de l’annonce de sa déchéance. Devant l’ampleur de ce qui était une « malédiction », mais aussi un scandale, même son oncle influent et bienveillant ne pourrait lui garantir aucune protection. Et surtout pas l’impunité !Malgré la surveillance policière, les vérifications techniques et les prières du Docteur Ravavalaku, un nouveau patient avait succombé aujourd’hui, le matin de ce vendredi maudit comme tous les autres ! Le Docteur Ravalavaku avait eu droit à un coup de téléphone du Directeur de Cabinet du Ministre qui lui demandait des explications. Même son oncle l’évitait ! Il était seul, abandonné par tous. Il n’avait naturellement pu fournir aucune justification de cette nouvelle mort. Le ton du Directeur de Cabinet avait été sec, tranchant, sans aucune marque de respect, preuve s’il en était encore besoin qu’il n’était plus le neveu prodigue ! Il en était là de ses sombres réflexions quand sa secrétaire lui annonça que l’officier de police Jaswant Raje désirait lui parler. Sans répondre il fit un geste las indiquant de faire entrer l’importun. Jaswant Raje déplaisait au plus haut point au Docteur Ravalavaku. Ce petit policier indien réservé, mais omniprésent le stressait ; son obséquiosité le faisait percevoir comme un être hypocrite et sournois. Mais cette fois, Raje était jovial et même exubérant :
-« Docteur, je voudrais vous montrer la cassette… »
Apathique, le Docteur Ravalavaku le regardait sans comprendre qui brandissait une cassette VHS d’un air triomphant…
-« Ah oui ! La cassette »…
Encore une idée saugrenue qui caractérisait le personnage : la surveillance de ses agents s’étant révélée infructueuse, Raje avait installé des caméras vidéo dans la salle de soins intensifs, comme s’il avait espéré prendre en flagrant délit, sur pellicule, des fantômes assassins ! Tout cela était ridicule, mais au point où il en était ! Le Docteur Ravalavaku acquiesça sans enthousiasme :
- « Parfait. Mettez la cassette dans le lecteur et voyons ce film .»
Le Docteur Ravalavaku se laissa tomber lourdement sur le canapé de son bureau, tandis que l’officier Raje demeurait debout à côté de lui, avec un sourire béat.Les premières minutes de visionnage furent sans intérêt : une infirmière discutant avec un médecin au chevet de la dernière victime en date de « la malédiction », puis une aide-soignante procédant à sa toilette sommaire… Le Docteur Ravalavaku, d’abord indifférent, montrait des signes d’impatience :
-« Et alors ? C’est comme ça tous les jours. Il n’y a rien d’extraordinaire… »
-« Attendez ! Voilà ! C’est maintenant ! »
Sceptique, le Docteur Ravalavaku reporta son attention sur l’écran… et ce qu’il vit le sidéra ! Raje dut arrêter le lecteur, rembobiner le film et repasser la scène… On y voyait l’aide soignante sortir de la salle pour laisser place à la femme de ménage qui nettoyait ces lieux une fois par semaine, le vendredi matin. Celle-ci se mit immédiatement à l’ouvrage… en débranchant et rebranchant successivement deux respirateurs artificiels situés à chaque extrémité de la pièce, le temps d’alimenter en courant sa cireuse de sol !
Raje interrompit le film au moment où la femme ressortait de la salle, impassible, inconsciente du caractère meurtrier de son geste… Le Docteur Ravalavaku, incapable de proférer un son, avait pourtant envie de hurler et de sauter à la gorge de ce policier qui semblait si satisfait d’avoir conjuré « la malédiction du vendredi matin ». Tout ça parce qu’il n’y avait pas de prise multiple et qu’une demeurée envoyée par une société sous-traitante arrêtait quelques minutes un appareil d’assistance respiratoire comme elle l’aurait fait avec un vulgaire micro-ondes ! Et le Docteur Ravalavaku eut envie de pleurer lorsqu’il se rappela que, quelques mois plus tôt, il avait rejeté une demande d’achat des économats de l’hôpital, au nom de la rigueur budgétaire. Cette demande concernait... des prises multiples ! Le Docteur Ravalavaku avait soupçonné qu’il ne s’agissait que d’une ruse pour contourner la coupure de la climatisation générale dans les bureaux et les salles de repos des personnels soignants, en branchant des ventilateurs personnels…
Le grain de sable
"Va où tu veux, meurs où tu dois"Au terme de sa visite officielle en France, Son Excellence le Général Mangalé Hnalaïne N'BO, le vice-premier ministre du Ghandalé, était en "soirée privée" dans une boite africaine de Saint-Germain, le Boué-Moué. Il n'y avait théoriquement que deux gardes du corps avec lui, plus un troisième qui attendait avec le chauffeur dans la Mercedes blindée garée devant le club. Jean-Marc Laads dut bien reconnaître que pour une organisation anti-gouvernementale de troisième ordre, le coup était parfaitement préparé. Il n' y eu pas de changement d'itinéraire de dernière minute. N'BO était bien dans ce boui-boui de luxe, à "claquer" en quelques heures l'équivalent d'une année de salaire de plusieurs de ses camarades restés au pays et laissés à leurs rêves révolutionnaires pas encore tout à fait émoussés.
Jean-Marc faisait le guet au premier étage d'un immeuble situé en face du Boué-Moué. Comme pour s'assurer par réflexe de sa présence, il posait de temps à autre la main sur le lance-roquettes antiblindé wasp, appuyé contre le mur, juste devant lui. Le verre de la fenêtre avait été prédécoupé. Une poignée de vitrier était fixée en son milieu, prête à dégager en une seconde l'espace nécessaire à la visée. N'BO était arrivé vers 23h30. Jean-Marc l'avait précédé d'1h30. Il était maintenant 2h45 et l'attente se prolongeait. Chaque fois que la porte du club s'ouvrait, laissant échapper un petit groupe de clients, Jean-Marc saisissait le wasp. A 3h30, Jean-Marc fut de nouveau alerté par une sortie. Cette fois il reconnut la haute stature des deux gardes du corps qui avaient escorté N'BO dans la boîte. Puis N'BO lui-même qui titubait, accroché à deux filles, une blonde et une asiatique qui, vu leur air enthousiaste, avaient dû déjà négocier les conditions de leur escapade exotique et tarifée... Dommage qu'elles n'en aient pas connu le prix complet, songea Jean-Marc presque compatissant.
Tout le groupe était maintenant devant la voiture d'où étaient sortis le chauffeur et le troisième garde du corps. N'BO gesticulait et vociférait, insultant de toute évidence le chauffeur et ses gardes du corps qui avaient dû lui faire remarquer qu'il était imprudent d'embarquer les deux filles. Voulant éviter toute précipitation, Jean-Marc avait laissé la poignée de vitrier en place, mais restait vigilant, prêt à agir. Après plusieurs minutes de palabres et de vociférations, N'BO plaça les deux gardes du corps à côté du conducteur, le troisième se tassant à l'arrière en sa compagnie et celle des filles qui seraient sans doute les dernières à se plaindre d'une quelconque promiscuité ! Avant même que la dernière portière se soit refermée, Jean-Marc avait retiré la lentille de verre de la fenêtre et épaulé le wasp. Il cala la visée à mi-hauteur du véhicule, au niveau de la banquette arrière. Le départ de la roquette le fit reculer d'un pas. Il dû revenir à la fenêtre pour voir le lourd véhicule en flammes retomber de biais et s’immobiliser sur le flanc, obstruant l'entrée du Boué-Moué.
Abandonnant l’arme sur place, Jean-Marc sortit par l'arrière de l'immeuble et n'eut qu'à enfourcher un bootser qui l'attendait dans la cour. Moins d’une minute plus tard, il n’entendait déjà plus les cris et les appels au secours qui émanaient des abords du Boué-Moué. Il n'alla pas très loin, puisqu'il s'arrêta rue du Cherche-Midi, ouvrit une porte-cochère grâce au code qui lui avait été fourni la veille et se dirigea vers un des appartements du rez-de-chaussée où il trouva refuge, y dissimulant également son deux-roues.
Aux premières informations télévisées matinales, Jean-Marc eut confirmation que l'attentat avait tué la totalité des occupants de la voiture, mais également le portier de l'établissement et trois clients qui s'apprêtaient à quitter les lieux. Cinq autres noctambules avaient été brûlés, dont deux se trouvaient toujours dans un état critique.
Loin d'éprouver des remords à l'annonce de ces dégâts annexes, Jean-Marc accueillit ces nouvelles avec la satisfaction du devoir accompli : ses commanditaires tenaient à ce que l'assassinat de N'BO s'effectue dans des conditions particulièrement spectaculaires et provoque une réaction diplomatique vigoureuse des autorités françaises. Les arrières-pensées, les motivations et la stratégie des ennemis de N'BO n'intéressaient nullement Laads ; tout ce qui comptait, c'était la parfaite maîtrise dont il avait fait preuve et qui allait faire encore monter sa côte sur le marché souterrain mais si lucratif des assassins appointés.
~*~
Sur un vol d'Air France Paris - New York, Laads faisait le point sur son passé et imaginait, avec rigueur et réalisme, ce que serait son proche avenir.
La mission qu'il devait effectuer aux Etats-Unis serait la dernière de sa carrière. Son "client", président-directeur-général d'une compagnie multinationale pétro-chimique, avait des ambitions politiques qui, manifestement, n'avaient pas l'heur de plaire à ceux qui avaient décidé son élimination. Sa disparition serait-elle un bien ou un mal ? Etait-elle justifiée ? Laads ne se posait jamais ces questions. Toute réponse aurait d'ailleurs été forcément subjective. Pour lui, ce n'était qu'une affaire à traiter, avec professionnalisme.
A quarante ans, tueur à gages depuis douze années, Laads était responsable de l’élimination de dix-sept cibles pour le compte de gouvernements ou de mouvements divers, ce qui, en intégrant les "dommages collatéraux ", portait à une trentaine le nombre de ses victimes. Ses moyens d’action étaient les explosifs ou les armes à moyenne et longue portées. Bien qu'ancien militaire, Laads ne se considérait pas comme un combattant, mais tel un "simple exécuteur" qui évitait toujours l’éventualité d’une confrontation directe avec ses cibles. Que se serait-il passé si une de ses victimes avait pu le fixer dans les yeux au moment de perdre la vie? Laads aurait-il pu sans état d'âme appuyer sur la détente d'un pistolet ou plonger une lame dans le corps de sa victime ? La proximité de sa victime aurait-elle chargé plus lourdement sa conscience qui ne l'avait jamais torturé, malgré tout le sang versé ? Même si cette idée l'avait parfois effleurée, Laads l'avait rapidement chassée de son esprit. Il raisonnait de manière binaire et égocentrique : le contrat était-il réalisable ou non ? Présentait-il un danger pour lui ou pas ? Ceux qui le recrutaient étaient-ils sérieux et garants de son anonymat ou des amateurs qu'il devait repousser ? Le choix à faire présentait-il plus d'avantages pour lui que d'inconvénients ? Toutes ses décisions étaient exclusivement motivées par la seule satisfaction d'un mieux-être matériel et l'indispensable préservation de sa sécurité. Alors, quant à d'hypothétiques remords… Laads jeta un regard semi-circulaire sur les passagers voisins : ce gros homme au visage couperosé qui transpirait d'abondance en annotant fébrilement les feuillets d'un volumineux dossier paraissait en proie à une panique intérieure ; peut-être que, suite à la lecture par d'autres de ce rapport, des têtes tomberaient, celles de combien d'innocents ? Celle de l'auteur peut-être si le rapport n'était pas à la hauteur ? Cette femme qui commandait à l'hôtesse whisky sur whisky et qui semblait si nerveuse en retirant subrepticement l'anneau de sa main gauche, signe d'une rupture annoncée ou déjà consommée qui allait briser la vie d'un mari, d'une famille entière ? Et cet homme au visage de fouine et à l'air sournois qui semblait perdu dans ses rêveries, un sourire extatique mais cruel aux lèvres, mettrait-il sa riche tante grabataire dans un hospice pour mieux la dépouiller ? En prêtant ces scénarios, non, Laads ne se considérait pas comme un monstre, ni plus ni moins qu'un autre…
D'ailleurs, dans quelques semaines, il tournerait définitivement le dos à sa double vie pour mener une existence paisible dans le Sud de la France, à Saint-Maxime. Il y achèterait une somptueuse villa et vendrait la brasserie qui lui servait de couverture à Paris pour prendre sa retraite, de toutes ses activités, officielle et clandestine, en pleine force de l'âge. Il ne restait plus que cette mission new yorkaise à exécuter pour pouvoir enfin profiter de la fortune qui l'attendait sur les comptes bancaires anonymes de plusieurs paradis fiscaux.
~*~
Laads n'avait pas de bagages enregistrés, seulement un sac de voyage qu'il avait gardé avec lui, contenant quelques effets de rechange, le strict minimum. A 21h10, un quart d'heure seulement après l'atterrissage, il avait pu quitter le terminal 1 de l'aéroport J.F Kennedy en taxi, direction Manhattan. Un peu plus tard encore, Laads, douché et rasé de frais, était assis dans le confortable canapé d'une suite du Marriott Financial Center situé sur West street. En face de lui, un téléviseur fonctionnait, le son coupé. Les gesticulations et les vociférations muettes d'un chanteur de rock avaient quelque chose de grotesque. Mais, en réalité, Laads fixait l'écran sans vraiment le voir, accordant plus d'attention à sa montre qu'il consultait fréquemment. Ce n'était pas un signe de nervosité qui aurait pu démentir son attitude impassible, mais le souci du timing dont dépendait le bon déroulement de sa mission.
A 0h30, il sortit et s'arrêta à la réception pour y déposer la clé magnétique de sa chambre. L'employé de service, avec une discrétion toute professionnelle, sut réprimer un sourire de connivence envers ce touriste célibataire qui, à peine arrivé, partait s'encanailler dans la nuit new yorkaise.
Laads sortit de l'hôtel et commença à remonter nonchalamment West street vers le nord. Il n'avait pas parcouru plus de cent mètres qu'un individu vêtu d'une combinaison d'ouvrier l'aborda, une cigarette à la main :
-Excusez-moi Monsieur, auriez-vous du feu ?
-Non désolé, j'ai arrêté de fumer aujourd'hui.
-Ce n'est pas grave. De toutes façons, j'ai décidé d'arrêter moi aussi dit-il en remettant la cigarette dans son paquet. Je m'appelle Pablo. Je suis du Costa Rica. Est-ce que vous connaissez-vous le Costa Rica ?
-Non, mais je compte le visiter bientôt avec ma femme.
Ce dialogue surréaliste s'était déroulé en espagnol, sur un ton monocorde de part et d'autre. C'était un code de reconnaissance assez ridicule mais écartant tout risque de méprise. Pablo était bien le contact de Laads. Le prétendu costaricain fit demi-tour et Laads lui emboîta le pas, cette fois-ci à plus vive allure. Près de Liberty street, Pablo fit signe à Laads de monter à l'arrière d'une fourgonnette Chrysler aux vitres teintées qui était stationnée, sans occupants. A l'intérieur, Laads y trouva les mêmes vêtements que portait Pablo. Dès qu'il eut revêtu les combinaison et casquette oranges et remplacé ses chaussures de ville par des baskets, il examina le contenu du sac que lui avait tendu son compagnon : un badge d'identification d'une société de nettoyage au nom de José Echandi, des gants hygiéniques qui éviteraient les empreintes digitales, une plaque de pâte blanche de cinq centimètres par dix centimètres environ et de quatre centimètres d'épaisseur et pesant à peine trois cents grammes qui était du C4, un explosif plus puissant que le T.N.T, un détonateur contenu dans un petit boîtier avec un écran à cristaux liquides, sensiblement du même poids d'où sortaient deux courtes électrodes rigides et griffues et enfin une télécommande ultra légère qui, elle, ne devait pas excéder cinquante grammes. Laads enfila les gants, épingla le badge sur sa poitrine et répartit le reste des objets dans chacune des poches de son vêtement de travail. Puis, ils sortirent du véhicule et poursuivirent leur marche vers le nord, sans mot dire jusqu'à destination.
Parvenus dans le hall de l'immeuble, ils prirent l'une des files composées de dizaines d'hommes portant le même uniforme qu'eux, des noirs et des latinos pour la plupart, qui présentaient leur badge aux agents de sécurité, avant de s'engouffrer par vagues successives dans les ascenseurs qui les distribueraient aux différents étages. Laads, collant Pablo, passa le contrôle sans encombre. Ils ne furent pas les derniers à être régurgités par le rapide ascensceur qui s'arrêtait à tous les étages, mais plus des deux tiers étaient déjà sortis aux niveaux inférieurs lorsqu'ils parvinrent sur leur lieu de travail, à 1h du matin.
De longues heures pénibles s'annonçaient, car Laads devrait, comme Pablo, effectuer réellement le travail qu'il était censé assurer dans les bureaux et les couloirs, manier la cireuse de sol, nettoyer les portes vitrées, vider les corbeilles et autres menues corvées pour ne pas éveiller les soupçons des rondiers en se tournant les pouces, ni alerter les gardiens à l'accueil en repartant bien avant les autres agents de nettoyage. Vers 2h, un vigile qui faisait sa tournée d'inspection s'adressa à lui :
-Salut ! Tu es nouveau toi ? C'est la première fois que je te vois ici.
Peu enclin à engager la discussion, Laads répondit en espagnol :
-No señor, soy temporal.
Le gros vigile roux et ventripotent, vraisemblablement un américain irlandais, secoua la tête en signe de désapprobation et grommela quelque chose où il était question de "métèques qui n'étaient même pas foutus d'apprendre à pas parler notre langue mais qui se débrouillaient pour piquer le boulot des bons américains"… Lors de ses rondes suivantes, il n'adressa plus un seul regard à Laads.
A 8h10 Laads approchait du but. Pablo et lui était dans la zone des bureaux de direction de la société appartenant à sa cible. Le bureau visé serait le dernier dont ils s'occuperaient. Laads fit signe à Pablo de ralentir le rythme pour respecter le minutage de l'opération. Le C4 devait être mis en place au dernier moment pour minimiser les risques qu'il soit repéré. Ce risque était quasiment nul, puisqu'il aurait fallu qu'un employé se mette à quatre pattes sous le bureau de la cible, mais Laads, comme à son habitude, préférait un luxe de précautions à la persistance, même infime, d'une possibilité de complications. Les premiers employés zélés commençaient à arriver. Selon les informations fournies, la cible elle-même s'asseyait chaque jour, rituellement, à son bureau à 9h précises, en respectant les mêmes horaires que son personnel, sans doute pour donner l'exemple. A 8h30, Laads désigna discrètement le bureau du boss. Dès qu'ils pénétrèrent dans cette pièce d'au moins cent cinquante mètres carrés, Pablo se mit à son ouvrage habituel, accélérant le mouvement puisqu'il devait prendre en charge la part de son coéquipier, en l'occurrence Laads occupé par une autre tâche. Le plus naturellement, Laads s'accroupit derrière l'immense bureau directorial et plaqua la charge de C4 sous son tablier d'acajou en l'étalant aux coins pour la faire adhérer, puis planta les électrodes du détonateur dans la pâte malléable et enclencha l'interrupteur.
Il ne lui restait plus qu'à ressortir de l'immeuble, et monter sur le toit terrasse de l'immeuble voisin qui accueillait, dès 9h, les visites payantes des touristes souhaitant admirer New York d'en haut et de diriger la télécommande sur les fenêtres vitrées de ce bureau qui lui ferait face. Le C4 était suffisant pour coller sa cible au plafond en une gerbe sanglante. Il suffirait de s'assurer qu'elle serait à son bureau en l'appelant sur sa ligne privée en prétextant un appel du Sénat que le milliardaire ambitieux projetait d'intégrer. Tout était prévu dans les moindres détails : l'appel serait censé provenir du secrétariat du sénateur républicain Samuel Whiteford, un des chevaux de Troie en politique de la cible. Jusqu'ici, tout fonctionnait à merveille. Laads se releva, regarda une nouvelle fois sa montre - 8h48- et, d'un mouvement de tête, donna à Pablo l'ordre du départ. Celui-ci ne se fit pas prier et précéda Laads vers la sortie. A l'instant précis où ils atteignaient le seuil de la pièce, Laads eut une sensation de vertige. Lorsqu'il vit Pablo manquer de perdre l'équilibre juste devant lui, il réalisa que c'était tout l'espace autour de lui qui vibrait, comme dans les prémisses d'un tremblement de terre. Dans le même temps, il sentit une présence derrière lui et ses sens en alerte l'avertirent d'un danger imminent. Il se retourna et ce qu'il vit à travers la paroi vitrée du bureau lui fit craindre, une seconde, d'avoir perdu la raison. Rien, auparavant, malgré les risques encourus, n'aurait pu le préparer à la vision qui s'offrit à lui. Laads, d'habitude si apte à analyser toutes les situations, si prompt à prendre les décisions adéquates, se retrouva ébahi et figé face au museau monstrueux d'un avion qui semblait foncer droit sur lui. Quelques minutes plus tard, ce ne fut pas l'attentat préparé par Laads qui retint l'attention du monde entier, mais un autre, phénoménal, inconcevable et dont le premier volet fut le crash volontaire d'un boeing 767 de la compagnie United Airlines détourné par des terroristes fanatiques, sur le 87ième étage de la tour nord du World Trade Center. Le point d'impact du nez de l'avion fut exactement le bureau que s'apprêtait à quitter Laads qui fut pulvérisé alors qu'une idée incongrue lui venait à l'esprit : le choc risquait de faire exploser le C4 !
Après plusieurs mois d'enquête, le FBI et les autres services de police et de renseignements américains n'avaient pu établir de lien avéré entre le plus tragique attentat de l'histoire et la disparition subite de son hôtel d'un touriste français, un certain Patrick Gantier. De plus, l'hôtel ayant été évacué de tous ses occupants, suite au désastre des tours voisines, bien des touristes ne donnèrent plus de nouvelles, soit qu'ils se soient relogés de leur propre initiative dans d'autres établissements, soit qu'ils aient tout simplement quitté la ville, en proie à la panique comme des milliers de New Yorkais qui avaient été les témoins tristement privilégiés de cette scène de fin du monde. Tout ce que put révéler l'examen de l'identité de Patrick Gantier, fut qu'elle était fausse. La brigade de recherche des personnes disparues de la police française ne put davantage relier aux événements du 11 septembre 2001 la mystérieuse disparition du patron d'une brasserie parisienne, à laquelle, d'ailleurs, elle ne s'intéressa guère puisque le sujet était majeur et sans famille. Après un semblant d'enquête sous l'insistance du personnel de la brasserie, le dossier fut rapidement archivé dans l'attente d'éventuels faits ou témoignages nouveaux. Pour la première et dernière fois, Jean-Marc Laads fut fiché sous deux noms différents par les polices de deux continents, non comme assassin, mais comme victime présumée.
Joyeuse fête
« Dans l’haleine des roses tu respires la mort » (Alexander Pope)
- Monsieur Magnier, je vous rappelle que c’est la saint Michel aujourd'hui !
C’était en effet le jour de la fête du saint patron des parachutistes, mais surtout celle de ma femme. Seule Mademoiselle Certa, qui travaille à mes côtés depuis dix ans, pouvait se permettre de me recommander de ne pas oublier cette fête. N’importe quel autre employé de ma société se serait fait souhaiter la sienne et octroyer, sur-le-champ, plus de temps libre qu’il ne l’aurait souhaité.
Il m’est souvent arrivé d’oublier et même, parfois, de l’ignorer délibérément dans le passé. Ce fut, à chaque fois, payé d’un prix exorbitant que seule une femme venimeuse et acariâtre comme Michèle savait exiger… et obtenir !
Mais aujourd’hui, aucun risque de manquer cet événement que je prépare depuis plus d’un mois.
- Oui, je sais Mademoiselle Certa. Justement, je voulais solliciter votre aide. Je voudrais réserver une table pour deux à La Tupina pour ce soir. Auriez-vous la gentillesse de vous en occuper ? Moi, je sors un moment. Je vais acheter des fleurs pour Michèle.
Depuis plusieurs semaines, je m’applique à convaincre Mademoiselle Certa, par des remarques ou des attitudes anodines, que mon mariage, naufragé depuis cinq ans au moins, avait retrouvé un heureux second souffle. Je ne manquais pas de décommander des dîners d’affaires, expliquant à Mademoiselle Certa en rougissant presque comme un collégien amoureux, que j’avais promis à Michèle de l’accompagner au théâtre ou à l’opéra. Ce que je faisais consciencieusement. Au début, Mademoiselle Certa avait manifesté un total ébahissement, ce qui se traduisait chez elle par un imperceptible haussement de sourcils. Elle s’était rapidement accoutumée à mes attentions conjugales retrouvées, en collaboratrice efficace et discrète, sans qu’il me fut possible de savoir avec certitude si elle était convaincue de la réalité de ce changement.
Un fait récent, survenu quatre mois plus tôt, rendait cependant plausible ma métamorphose : Michèle avait été victime d'un accident cardiaque bénin qui lui avait valu une courte hospitalisation. J'essayais donc d'accréditer l'idée que, me sentant coupable d'avoir abîmé sa santé en la contrariant si souvent, je faisais tout mon possible pour me racheter une conduite.
Michèle fut tout d’abord surprise par ma métamorphose. Puis, elle finit par accueillir cette situation nouvelle comme une promesse de résurrection de notre couple. Elle s’en était visiblement ouverte à son entourage puisque ses amies, qu’il m’arrivait de croiser lorsque je rentrais chez nous, me témoignaient de toutes récentes marques de bienveillance, sinon de sympathie. Que ce fut de la courtoisie ou de la crédulité, ces "amabilités" m’encourageaient dans mon entreprise, car la seule personne qui jusqu'alors me ne faisait pas sentir son mépris sous mon propre toit, était le professeur de gymnastique particulier de Michèle qui l'accompagnait dans sa remise en forme après son infarctus.
J’avais également pris soin, un mois plus tôt, de rompre avec Maryline, ma maîtresse du moment. Une douzaine, parmi la centaine qui composait l’effectif féminin de mes employés, l’avait précédée à ce statut. Toutes avaient retrouvé, sans préjudice ni avantage aucun et surtout sans discours superflu, l’anonymat de leur fonction professionnelle. J’avais pourtant expliqué solennellement à la malheureuse Maryline que je désirais reconstruire mon couple et que notre rupture devait être radicale. Elle avait donc été licenciée, dans le cadre d’une très opportune restructuration d’entreprise, avec une très généreuse indemnité, et immédiatement recrutée par un de mes amis auquel j’avais déballé, confus, les raison de ce service que je quémandais en mari "dans l’embarras".
J’avais fait tout mon possible pour accréditer l’image de l’époux fautif repentant et aimant. Ainsi paré de ce bouclier presque vertueux, j’envisageais avec sérénité et confiance l’imminence du combat que j’allais livrer, puisque j’avais décidé …d’assassiner ma femme !
~ * ~
Michèle est la fille de Pierre Castanède, l’homme qui a fondé à Bordeaux la Société des Transports d’Aquitaine que je dirige aujourd’hui. J’ai intégré cette entreprise, il y a dix ans, grâce au frère de Michèle, Jean-Claude, mon condisciple à H.E.C. Ce dernier avait fait appel à moi pour le seconder, lorsqu’il avait pris la succession de son père décédé. Je pense que ce fut autant en souvenir de nos frasques communes d’étudiants, qu’en raison de mes qualités de gestionnaire qu’il savait supérieures aux siennes. Jean-Michel était un "enfant gâté", intelligent certes, mais élevant le dilettantisme au niveau d’un art de vivre. J’avais donc assumé les fonctions de dirigeant de la société, bien avant d’être officiellement investi. Pendant deux ans exactement, jusqu’à la mort de Jean-Michel, survenue lors d’un accident de la circulation sur la route de Soulac-sur-mer. Michèle, sortant tout juste d’un divorce pénible, m’avait demandé d’assurer la continuité de l’entreprise familiale.
La disparition de mon ami m’avait naturellement choqué, mais j’avais dans le même temps considéré, avec une lucidité à la limite du cynisme, les perspectives qui s’offraient à moi. Tâcheron et homme de l’ombre, j’allais devenir le numéro un de la société que j’avais considérablement développé depuis mon arrivée. Outre son activité initiale de transport de marchandises, la SOTRAQUI s’était diversifiée sous mon impulsion, en s’ouvrant au transport touristique. Des voyageurs sillonnaient l’Espagne et la France, avec des incursions au-delà des frontières allemande, suisse et belge. J’envisageais également, à brève échéance, des investissements dans des relais gastronomiques du Médoc.
Mais si un titre m’avait été octroyé, le vrai pouvoir demeurait dans les mains de Michèle Castanède, sans enfant et désormais seule propriétaire. Dès lors, célibataire moi-même, je consacrais tout mon temps libre à soutenir une femme affligée par les pertes, en à peine plus de deux ans, d’un père, d’un frère et d’un mari cardiologue qui, après cinq ans de mariage, lui avait préféré une jeune interne en médecine.
Je sus convaincre Michèle de la nécessité pour elle de s’impliquer dans l’entreprise, afin de se soustraire à sa morosité. Je requerrais sans cesse son approbation pour la mise en œuvre de décisions stratégiques, alors que rien ne m’y obligeait statutairement. En réalité, je sus lui donner l’illusion de participer à mes initiatives, alors qu’aucune disposition particulière ne l’y préparait. Nos rapports devinrent rapidement plus intimes que professionnels. Un an après le décès de Jean-Michel, j’épousais Michèle et emménageais au domaine familial des Castanède, à une quinzaine de kilomètres de Bordeaux, à proximité du fameux château de La Brède où naquit Montesquieu.
Je dois à la vérité de dire que, ni la cour assidue que je fis à Michèle, ni les trois premières années de notre mariage ne m’ont contraint à une hypocrisie excessive. Bien sûr, je n’avais jamais éprouvé une passion dévorante et mes sentiments se situaient certainement loin en deçà de ceux de Michèle à mon égard, mais Michèle était une femme intelligente, cultivée et séduisante qui me rappelait à tout instant ma réussite sociale. Sur le plan physique, cette épouse à la quarantaine resplendissante me comblait également. D’ailleurs, complètement immergé dans les tâches indispensables à l’expansion projetée de mon entreprise, je n’avais guère le temps et le goût de m’intéresser à d’autres femmes.
~ * ~
Lorsque j’avais pu prendre le temps de souffler et de me retourner sur le chemin parcouru, le bilan m’était apparu incontestable. Elevé dans un milieu de petits fonctionnaires, je vivais maintenant dans une somptueuse demeure plus que centenaire, occupée précédemment par Jean-Michel, et par son père avant lui ; en guise de pied-à-terre à Bordeaux, je disposais d’une maison de style Louis XV dans le quartier Saint-Pierre, où Michèle avait habité avant son divorce ; les biens propres de Michèle, ajoutés aux valeurs immobilières et boursières dont elle avait hérité des défunts me plaçaient, par la communauté de notre régime matrimonial, à la tête d’une des premières fortunes bordelaises, voire d’Aquitaine.
J’avais en quelque sorte chaussé les sabots des morts et raflé des œufs que d’autres avaient couvés…Mais la SOTRAQUI ? Le décuplement de son chiffre d’affaires depuis mon arrivée n’était pas dû aux Castanède, mais à moi seul ! Et surtout pas à une épouse qui m’apparaissait soudainement comme un boulet trop longtemps supporté !
Nos liens s’étaient alors distendus. J’avais eu des aventures, mais sans jamais m’attacher. Michèle l’avait appris et j’eus droit à des scènes terribles allant des menaces de suicide à celles de divorce. J’avais toujours nié, énergiquement d’abord, distraitement par la suite, pour finir par ne plus répondre. Nous avions fait chambre à part et il m’arrivait fréquemment de passer des nuits à Bordeaux, pour être proche de notre siège en ville et à pied d’œuvre aux aurores le lendemain, prétendais-je. Bien sûr, Michèle ne me croyait pas et je m’en fichais éperdument. Mes liaisons étaient d’ailleurs notoirement connues, puisque le seul endroit où je ne m’étais pas affiché avec mes maîtresses était le domaine de La Brède.
Nous n’avions pas d’enfant. Je n’en désirais pas. Michèle ne pouvait pas en avoir et le fait d’avoir été mariée à un médecin n’y avait rien changé. J’étais rassuré sur ce point. Les choses auraient pu durer en l’état, avec les régulières crises de colère ou les allusions perfides de Michèle, ses reproches et parfois ses insultes que j’accueillais stoïquement. Mais Michèle avait à nouveau brandi la menace du divorce. Le fait me semblait devoir, cette fois, être pris au sérieux. Michèle avait pris conseil auprès d’un avocat et n’aurait certainement eu aucun mal à me faire attribuer tous les torts. Quitter La Brède, abandonner richesse et vie confortable ne m’effrayait pas démesurément. Ce qui, en revanche, me terrifiait, c’était la possibilité de me séparer de la SOTRAQUI qui n’avait plus rien en commun avec le mammouth ronflant et végétant des Castanède. D’une certaine manière, j’avais créé la SOTRAQUI. Jamais, je ne supporterais de la perdre. Cela, Michèle l’avait parfaitement compris. Elle m’avait clairement exposé que son objectif principal était de me retirer tout ce pour quoi je vivais.
Sous les apparences d’une capitulation et d’une contrition, j’avais décidé de contre-attaquer. Il n’était nullement question de démanteler la société en vue d’un partage ou devenir l’employé de mon ex-femme. L’analyse de la situation n’avait pas été longue, avant de considérer le veuvage comme issue la mieux seyante à mes ambitions intactes.
Je repensais à tout cela chez le fleuriste, d’où je faisais expédier à La Brède un énorme bouquet de roses blanches et jaunes parsemé de quelques magnifiques orchidées. J’achetais aussi trois roses rouges et un vase translucide que je gardais avec moi.
J’avais quitté le bureau exceptionnellement tôt, pour revenir à La Brède vers seize heures trente. Je savais Michèle absente à cette heure-là puisqu'elle m'avait confirmé qu'elle participait, comme tous les jeudis, à une réunion de son club féminin d'aide sociale avec les riches mégères désœuvrées de son acabit. Tant mieux ! Il m’importait d’être seul : j'étais allé la cuisine verser de l'eau dans un vase pour y placer les roses rouges et l’avais transporté dans la chambre où je dormais encore seul ; après avoir procédé à quelques autres préparatifs, j’avais refermé la porte à clé et j’étais allé attendre Michèle dans le grand salon.
~ * ~
Lorsque Michèle est revenue, à 18 heures, elle m’a remercié pour les fleurs livrées plus tôt dans l’après-midi. Ce fut avec une gentillesse teintée d'une certaine condescendance. D’ailleurs, je n’avais pas vu les fleurs qui devaient être dans la chambre de Michèle. Ma chère épouse avait donc préféré ne pas les laisser en vue. Elle voulait sans doute me signifier ainsi qu’elle restait sur ses gardes. Elle accepta néanmoins sans difficulté mon invitation à dîner dehors. Deux heures plus tard, nous étions dans ce fameux établissement de la Porte de la Monnaie. La Tupina est une des grandes tables de Bordeaux, mondialement renommée, mais sans l’aspect guindé de la plupart des établissements de ce rang. Son décor de ferme, sa cheminée centrale dans laquelle rôtissent des volailles au tournebroche à côté du chaudron où mijote une soupe odorante, garantissent la chaleur et l’intimité que je tenais à donner à cette soirée en tête-à-tête avec Michèle.
Le dîner se déroula dans d’excellentes conditions. Je fis honneur au caviar d’Aquitaine, au foie gras des Landes poêlé au raisin garni de pommes sarladaises et à la crème brûlée au pain d’épice. Un sauternes blanc château Rieussec grand cru 1987 contribua largement à créer l’atmosphère détendue que je recherchais. Je parlais beaucoup et mangeais tout autant ; Michèle très peu, mais elle m’écoutait avec une attention comme seules les femmes amoureuses savent véritablement accorder. Je n’avais pas revu telle attitude depuis longtemps. J’évitais de parler de travail, évoquant plutôt des sujets plus futiles et insistais sur mon envie croissante de prendre des vacances en Espagne ou au Maroc. Avec Michèle, évidemment ! Cette hypothèse sembla rencontrer son approbation, car elle souligna, qu’en cette saison, mieux valait descendre le plus au sud possible.
Dans la voiture, sur le chemin du retour, je mis en route le lecteur laser dans lequel j’avais pris soin de programmer la 5ème symphonie de Beethoven afin de maintenir l’ambiance de cette soirée. Michèle semblait somnoler, mais j’étais convaincu qu’il n’en était rien. Sans doute devait-elle évaluer cette nouvelle soirée réussie, la sincérité de mes prévenances et les bienfaits de ces premières vacances que nous pourrions prendre ensemble prochainement.
Je conduisais lentement, en silence, passant en revue les actes que je devrais effectuer à notre arrivée à La Brède.
L'année précédente, j’étais allé passer un week-end avec Maryline à Condom, dans le Gers, chez mon ami Christian Desarmagnac. Celui-ci, en gentleman-farmer du dimanche, élevait pour le plaisir des volailles en semi-liberté. Son élevage avait été la cible d’attaques répétées de chiens du voisinage. Christian avait donc décidé d’éliminer les prédateurs. Etant chimiste industriel, il avait eu l’idée d’utiliser de fines ampoules remplies d’un mélange gazeux à l'effet létal. Quand Christian m’avait expliqué les déboires de son élevage et le procédé pour y remédier, j’avais spontanément prétexté des attaques similaires contre Cyrano, le cheval de Michèle, trop vieux pour être encore monté et qui finissait paisiblement son existence dans le pré jouxtant notre parc. Christian eut d'abord quelques réticences à me donner les trois ampoules qui lui restaient à Condom, mais finit par céder en prenant soin de me mettre en garde sur les dangers de ce gaz. En dehors de l'ingestion par un animal, le dispositif pouvait également être mortel lors du bris de l'ampoule ; le gaz incolore et inodore se dilatait alors au contact de l'air, mais plus dense que celui-ci, stagnait en un volume égal à peu près à deux ballons de football ; l'inhalation pendant deux ou trois secondes suffisait à provoquer une issue fatale, selon un processus agissant sur le sang - que Christian me résuma dans les grandes lignes - et qui aboutissait à un arrêt cardiaque ; si l'ampoule venait à se casser par accident, il convenait donc de demeurer à un mètre de l'émanation qui se dissipait, dans un espace non confiné, au bout d'une demi-heure environ, sans plus aucun risque.
Je ne savais pas pourquoi j’avais inventé cette histoire. Certainement, parce qu’avait déjà germé dans mon cerveau l’idée encore confuse du plan que je m’apprêtais à réaliser. J’avais libéré toute la rage d’un véritable mort de faim au service de mon ascension. Je n’allais pas, à quarante-deux ans, me résigner à tout perdre, sans lutter, sur un simple caprice de Michèle et au gré de ses ressentiments.
~ * ~
A notre arrivée, je continuais à me montrer prévenant et je proposais à Michèle de nous servir une coupe du champagne que j'avais mis au frais pendant qu'elle irait se changer pour être plus à l'aise. Elle me répondit avec un sourire un peu absent, comme si elle flottait entre rêve et réalité :
- D'accord. Donne-moi quelques minutes.
- Prends ton temps ma chérie.
Dès qu'elle eut quitté la pièce, je me précipitais dans ma chambre ; pour y chercher les roses, ainsi qu'une des trois ampoules de gaz cachées dans le tiroir de mon meuble de chevet et une règle triple décimètre en fer. Mes gestes étaient mécaniques et précis, tant de fois j'avais répété mentalement et même simulé cette scène en situation. Je revins dans le salon et disposais le vase, non pas sur la table basse, mais sur une commode assez haute pour que les fleurs soient à peu près à hauteur du visage de Michèle. A la tige de l'une d'elle, j'avais noué une cordelette de velours qui passait à l'autre extrémité dans l'œillet d'une carte de vœux, sur laquelle j'avais écrit "avec mon amour, joyeuse fête Michèle". Je ne voulais pas donner la possibilité à Michèle de s'éloigner du piège pour lire ce message d'amour empoisonné. Je laissais tomber l'ampoule au fond du vase et j'ai introduit la réglette dans le vase ; à travers la paroi transparente, je n'ai eu aucun mal à en diriger le bout carré au dessus de l'ampoule et, d'un coup sec, à écraser celle-ci ; je me suis reculé vivement pendant qu'un gros mais bref bouillonnement se produisait dans le récipient, en éjectant quelques gouttes ; j'ai prestement jeté la tige de métal sous le canapé et je me suis rendu dans la cuisine pour aller y chercher le champagne ; en prenant les coupes, je me suis aperçu que mes mains commençaient à trembler et j'étais trempé de sueur.
~ * ~
J'étais revenu au salon depuis cinq minutes au moins, la bouteille et les coupes remplies étaient sur la table basse et j'attendais Michèle debout, en essayant de me retenir de faire les cent pas et je m'efforçais de faire le point sur la suite des opérations.
Si tout se passait bien, j'irais chercher ses cachets qu'elle n'aurait pas pu prendre parce qu'elle avait perdu connaissance ; j'attendrais un quart d'heure avant d'appeler le docteur Sorant qui est un ami et aussi le médecin traitant de Michèle ; compte tenu de l'éloignement, le temps mis par les secours pour parvenir jusqu'à La Brède devrait être suffisant pour garantir une "issue favorable" même en supposant que le produit n'ait pas été efficace immédiatement ; compte tenu du passé médical récent de Michèle, il n'y aurait aucune raison de supposer autre chose qu'une banale crise cardiaque ; il faudrait que je me débarrasse sans tarder du vase, des roses, de la règle et des ampoules de gaz restantes… Mon esprit s'emballait, à la limite de la panique, mais ce n'était pas plus mal, puisque j'aurais à jouer le rôle du mari complètement dépassé par la situation.
Lorsque Michèle est entrée dans la pièce, j'ai été étonné de constater qu'elle ne s'était pas changée ; elle portait toujours son ensemble tailleur et même ses bijoux.
- Je nous ai servis ma chérie. Mais d'abord je voudrais te donner ceci… dis-je en lui désignant les roses.
Elle avait une attitude étrange ; elle s'était immobilisée à distance respectable de moi ; elle a porté le regard vers les fleurs et esquissé un sourire dans lequel j'ai cru déceler une sorte d'ironie qui a déclenché chez moi un malaise indéfinissable.
- Il y a un petit mot pour toi… tu … tu ne veux pas le lire d'abord ? ai-je hésité.
Michèle ne m'a pas répondu et m'a fixé, avec quelque chose dans les yeux qui maintenant m'inquiétait réellement. Puis, elle a tourné la tête vers l'entrée du salon. J'ai regardé dans la même direction et ce que j'ai vu m'a stupéfié : dans l'encadrement de la porte, se tenait un homme dont le visage me disait vaguement quelque chose…
- Mais qu'est-ce que…
En même temps que je me rappelais qui était cet homme, je m'apercevais d'un détail qui m'avait jusqu'alors échappé : cet individu, dont je n'avais sûrement jamais su le nom, était le prof de gym de Michèle… et il avait un revolver pointé sur moi !
Il est venu se placer au côté de Michèle, en me menaçant toujours de son arme. L'évidence m'est alors apparue lumineuse : ma fragile et vertueuse épouse et son complice, peut-être son amant ! J'aurais pu, dans d'autres circonstances, trouver la tournure des événements grand-guignolesque, mais plus encore que le revolver, c'était Michèle qui me terrifiait ; elle exprimait une haine silencieuse d'une intensité que je ne pouvais concevoir.
J'ai voulu établir un contact:
- Michèle, mais qu'est-ce qui se passe ? Michèle, parle-moi…
Elle n'avait visiblement pas l'intention d'entamer un dialogue, ni de me donner la moindre explication. Elle a seulement dit à son acolyte:
- Vas-y ! Tue-le!
Une faible détonation a précédé un choc violent dans ma poitrine. Plus que la douleur, le flot inondant ma bouche et le goût du sang m’ont fait mesurer la gravité de ma blessure. Je me suis dit que l'arme ne devait pas être de gros calibre, car l’impact ne m’avait pas rejeté en arrière, ni même fait reculer. J’étais demeuré sur place, le souffle coupé. J’ai baissé les yeux pour contempler un instant ma chemise blanche qui s’était ornée d’un plastron écarlate, avant de fixer à nouveau Michèle. Incrédule, je la découvrais telle que je ne l’avais jamais vue. Tous ses accès de violence verbale, voire physique, s’étaient toujours déroulés dans des moments d’hystérie. Or, j’avais face à moi une femme parfaitement calme et glacialement lucide. Lui, maintenait à deux mains son arme braquée sur moi. J’ai voulu prononcer le prénom de Michèle, ne parvenant à produire qu’un chuintement incongru, tandis qu’une brûlure atroce déchirait mes poumons qui ne semblaient plus fonctionner. J’ai pensé que, d’une quelconque autre manière, il me fallait renouer un lien avec elle pour gagner du temps. Ne pouvant lui parler, j’ai fait un pas pour m'approcher d'elle. C’est alors que l'autre a tiré pour la seconde fois. Atteint à nouveau à la poitrine, j’ai basculé en arrière, renversant dans ma chute le canapé auquel j’ai tenté de m’agripper.
Michèle et l'homme étaient hors de mon champ de vision. J’ai essayé de tourner la tête pour les voir, sans y parvenir. Je ne pouvais que fixer les roses à quelques mètres de moi. Seules les fleurs demeuraient nettes, au cœur d’un halo. Les alentours devenaient vaporeux, la réalité évanescente. Michèle a toujours adoré les roses. J’ai tenu pour certain qu'elle irait bientôt respirer leur parfum et lire mon dernier message. Je n’éprouvais plus aucune douleur et je me suis même senti sourire. Mais je gage qu’aucun muscle de mon visage n’a frémi. Joyeuse fête Michèle…
Un sale type« Il y a deux choses qui abrègent la vie : la folie et la méchanceté » (Baltasar Garcian y Morales)
A quarante ans à peine, de petite taille, plus large de hanches que d’épaules, très myope, une calvitie insidieuse le débarrassant rapidement d’un reste de chevelure achromatique, Eric Langefiel est maître de conférences en Histoire-Géographie à l’université Montpellier-III. Il compense son manque de prestance par l’affirmation de son autorité professionnelle. Obséquieux à l’égard de sa hiérarchie, il exerce en permanence une pression tyrannique sur ses assistants et ses élèves. Il adore également capter l’attention d’un auditoire, lors de conférences qu’il tient régulièrement à l’auditorium de la chambre de commerce et d’industrie ou dans l’amphithéâtre de l’université Paul Valéry.
En réalité, Langefiel n’est pas particulièrement brillant, loin s'en faut. D’une intelligence ordinaire et d’une capacité d’analyse des plus quelconques, il possède toutefois assez de rouerie pour choisir avec soin des sujets d’études qui n’intéressent que le plus petit nombre de ses collègues –et même, si possible, aucun- pour ne souffrir d’aucune comparaison. Il se réjouit de constater que le vivier des profanes qui tentent de se singulariser en assistant, par exemple, à ses interventions sur "l'évolution de l'influence de l'église sur les chants traditionnels en Micronésie, du XIXème siècle à aujourd’hui ", semble inépuisable. La connaissance constituant le véritable pouvoir, ces oisifs se considèrent alors les récipiendaires privilégiés d’un inestimable savoir qu’ils se feront un devoir, avec une suffisante supériorité, de distiller à leur tour à la multitude pour la plus grande gloire du petit maître. Cette troupe de chats bottés est nécessaire et presque suffisante à ce piètre Marquis de Carabas mégalomaniaque. Caricature bouffonne du Marquis de Sade également, car un dérisoire sentiment de puissance émerge de temps à autres dans la vie conjugale de Langefiel, grâce à une épouse fade, niaise et totalement soumise à ses déviations sadomasochistes.
Langefiel est un être prudent jusqu’à la frilosité. Son autoritarisme et ses abus de pouvoir ne sont destinés qu’à des individus socialement ou psychologiquement faibles. Il ne s’attaque jamais à ses pairs. Il ne s’agit pas de solidarité ou d’esprit de corps, mais simplement de la crainte d’une riposte qu’il sait être incapable d’encaisser. Pour autant, son caractère vindicatif est réel. Vis à vis de ses égaux ou supérieurs, il s’exprime de manière indirecte, sournoise mais redoutablement efficace. Langefiel a sapé des réputations, et même détruit des carrières. A l'encontre d'un collègue endeuillé par la disparition de sa femme, le poison fut injecté avec méthode :
- Je m’inquiète beaucoup pour Trubert. Il n’a pas l’air de surmonter le choc. Et cette rumeur selon laquelle il se serait mis à boire est insupportable. Il faut le soutenir au lieu de l’enfoncer. Je ne sais pas vraiment quoi faire, mais il faudrait l’aider !
Ces propos, onctueusement enrobés de générosité et d’indignation, furent naturellement adressés exclusivement aux pires ennemis de Trubert. Dès lors, l’intempérance alléguée de ce dernier, inconnue auparavant, fut un secret de polichinelle pour l’administration et les corps professoraux et estudiantins. Bien sûr, peu importait que Trubert n’ait jamais sombré dans l’alcoolisme, même aux moments les plus douloureux de son veuvage. Lorsque ces ragots, amplifiés, revenaient à lui, Langefiel protestait de plus en plus mollement :
- Non, je ne peux pas croire ça ! Vous êtes sûr ? Et bien, malheureusement, cela prouve que les plus solides d’entre-nous ne sont pas hors d’atteinte de l’adversité…Pauvre Trubert…
Trois mois plus tard, Trubert fut fermement invité à solliciter un congé de longue maladie pour dépression profonde. Langefiel récupéra l’entier bénéfice de leur contribution à un ouvrage universitaire collectif intitulé "cultures et religions en Océanie". Cette contribution avait été essentiellement apportée par Trubert, mais quelle foi aurait pu être accordée aux réclamations –qui ne vinrent jamais- d’un individu dont l’ivrognerie était devenue de notoriété publique ?
Ce n’est, en exemple, qu’un des épisodes de l’odyssée malfaisante de Langefiel, parsemée de "faits d’armes" anonymes dont il jouit solitairement, répugnant à les relater dans le détail à son épouse Tatiana. Celle-ci, jugée trop stupide pour apprécier à leur juste mesure ces sordides fourberies lui tenant lieu de machiavélisme, est pourtant le meilleur des publics du petit homme : point ne lui est besoin de comprendre pour admirer dévotement sa moitié en buvant ses paroles dont elle ne peut appréhender le quart, mais qu'elle reçoit comme l'hostie de la communion.
~ * ~
Pour une complète perception de Langefiel, il faut intégrer le personnage de Tatiana. Moins âgée de quelques années que son mari, elle forme avec lui un couple… étonnant !
Toujours maltraitée, rabrouée sans ménagement devant des tiers par Langefiel, il arrive parfois à Tatiana de s’abandonner à des sanglots convulsifs, sonores et grotesques qui provoquent davantage l’hilarité difficilement contenue des spectateurs de ces épanchements, que leur sollicitude. Tatiana n’en veut jamais à Langefiel. Ses seuls reproches s’adressent à elle-même, incapable de se hisser à la hauteur de cet époux d’exception.
Langefiel est athée ; Tatiana, catholique convaincue, n’a donc plus mis les pieds dans une église depuis son mariage ; Langefiel a également exigé qu’elle cesse d’apporter son concours bénévole au Secours Catholique et aux Guides de France ; Tatiana s’est exécutée sans protester ; prétextant une allergie pathologique, Langefiel a contraint Tatiana à se débarrasser de son chat, Farine, qui lui tenait compagnie depuis huit ans. Les incompatibilités et les allergies de Langefiel ne se limitant pas aux animaux de compagnie, il a évacué définitivement la question des enfants et obligé Tatiana, consternée mais obéissante, à se faire stériliser. Quant à la mère de Tatiana, dont celle-ci est pourtant la fille unique, Langefiel n’imagine même pas consacrer une seule journée de libre à la visiter à Perpignan. Eric ne l’a jamais formulé expressément, mais Tatiana sent bien que cette belle-mère, veuve d’un ancien employé de voirie municipale ne présente pour lui aucun intérêt, voire l’insupporte avec son accent et son allure si populacières ! Aussi, Tatiana n’a-t-elle pas revu sa mère depuis plus de deux ans, se contentant de l’appeler au téléphone. Et encore est-ce le plus possible à partir de son bureau, pour ne pas indisposer Eric. Originellement d’une pruderie et d'une pudibonderie à toute épreuve, Tatiana a aussi cédé aux extravagantes exigences sexuelles de Langefiel. Sans en retirer le moindre plaisir physique, elle éprouve néanmoins la satisfaction affective de satisfaire, et peut-être de combler son mari - du moins l’espère t-elle- sur un plan intime.
Tatiana est même honteuse de son emploi à la Recette Principale des Postes de Montpellier, au guichet philatélie. Comment pourrait-elle raconter ses banales et mornes journées de travail à celui qui évolue dans de si hautes sphères et dont il la tient soigneusement écartée ? Pourtant, une fois, une seule fois, l'année dernière, Tatiana s’est sentie utile à Eric, malgré son complexe d'infériorité : sur l’injonction de son maître adoré, elle a subtilisé des timbres courants à trois francs, mais présentant un défaut d’imprimerie et donc destinés à être détruits. Langefiel a déjà écoulé vingt et une des trente planches de cent timbres auprès d’officines philatéliques de Montpellier, Avignon, Aix-en-Provence, Marseille et Paris. Les anomalies des pièces dérobées ayant plus que décuplé leur valeur nominale, Langefiel a retiré un bénéfice important de son petit trafic. Manne dont Tatiana n’a nullement profité puisque la tenue du ménage est depuis toujours financée par son seul salaire, Langefiel ne lui donnant jamais un sou. Aujourd'hui encore, elle ne sait toujours pas ce qu’Eric peut bien faire de ses revenus très largement supérieurs aux siens. L’héritage conséquent, notamment en biens immobiliers situés à Montpellier, qu’a reçu Eric de son père décédé trois ans plus tôt, n’a absolument pas modifié leur train de vie. Le couple ne sort jamais. Ni théâtre, ni cinéma, ni concert, ni restaurant. Les besoins vestimentaires sont satisfaits au strict minimum, surtout pour Tatiana, Langefiel devant quant à lui assumer quelque peu les signes extérieurs de son appartenance à l’élite universitaire. Tatiana dépasse Eric d’une bonne demi-tête ; elle a donc interdiction de porter des chaussures à talons hauts. Sans avoir jamais été d’une beauté époustouflante, Tatiana était autrefois plutôt coquette. C’était avant son mariage, il y a quinze ans ; il y a une éternité, avant que l’angoisse permanente de décevoir Langefiel n’épaississe prématurément sa silhouette et ne bouffisse son visage. Pourtant, lorsqu’il arrive, très rarement, à Tatiana de s’examiner dans un miroir, elle croit y déceler encore la possibilité de retrouver un certain charme qui pourrait raviver l’intérêt d’Eric. Elle ne pense pas une seconde à d'autres hommes, même imaginaires ; hormis Eric, nul ne compte !Tatiana, souffre-douleur consentant de Langefiel, pourrait porter au front, avec extase et fierté, une inscription marquée au fer rouge "NÉE POUR SOUFFRIR". Souffrir pour LUI, pour ERIC évidemment ! C’est pourquoi Tatiana n’inspire généralement aucune compassion.
Amoral, égoïste, hypocrite, manipulateur, cupide, avare et bien d'autres choses plus abjectes encore… Langefiel est un pur concentré d’inhumanité. Tatiana, elle, n’est rien ni personne, même pas l'ombre d'Eric… Elle est la suprême insignifiance incarnée ! Le must d'une existence transparente et inutile !
~ * ~
La première rencontre en tête-à-tête entre Langefiel et le conseiller Michel Baldavini, adjoint au maire de Montpellier, eut lieu dans le bureau de l'édile.
Ce matin-là, en sortant de son appartement du Boulevard Sarrail, Langlefiel s’était hâté fébrilement vers la place de la Comédie pour y prendre le tramway à destination de l’Hôtel de Ville. Trois semaines auparavant, un vin d’honneur y était donné en raison du départ en retraite d’un universitaire, par ailleurs conseiller municipal. Langefiel n’avait pu que saluer le Maire, très entouré. En revanche, il avait réussi à discuter longuement avec un de ses adjoints, notamment de généalogie. L’élu s’était montré très intéressé et avait révélé à Langefiel qu’il aurait souhaité connaître plus précisément la partie de l’arbre de son ascendance originaire de la région montpelliéraine, l’autre étant d’origine italienne. Langefiel avait saisi avidement cette opportunité et proposé ses services et ceux du cercle auquel il appartient. L’adjoint avait paru assez gêné en déclarant ne pas vouloir abuser, mais Langefiel avait balayé ses objections en assurant que cela serait un plaisir pour lui et, surtout, une occasion d’assouvir une de ses grandes passions.
Après des recherches acharnées et anxieuses, Langefiel avait réuni des éléments qui avaient largement satisfait Baldavini. Au lycée, des démarches similaires sur des sujets quelconques, à destination de ses professeurs, l’avaient souvent fait traiter de "lèche-cul" par ses condisciples. A cette évocation, Langefiel a toujours eu un rictus de mépris. Il n’a jamais eu cure de ce que pouvait penser quiconque ne méritant pas de figurer dans son carnet d’adresses au titre de débiteur potentiel. Peut-être n’obtiendrait-il jamais rien de cet élu et il n’avait d’ailleurs rien de particulier à lui demander à l’époque. Mais, plus tard ? Aucune de ses actions n'était gratuite mais un investissement pour l'avenir. Et il sentait, assez confusément encore, que le moment de toucher les dividendes de son attitude servile se rapprochait…
Calculateur, Langefiel se définit plus encore par le caractère intuitif de son opportunisme qui a été payant une fois de plus. Baldavini l’avait chaleureusement remercié. Au cours des mois qui suivirent, les invitations à déjeuner et à dîner, seul à seul, s’étaient succédées, au rythme d’une ou deux fois par semaine, le plus fréquemment aux restaurants La Diligence et Le Chandelier. Baldavini réglait toujours la note, ayant repoussé d’emblée les protestations de pure forme de Langefiel, soulageant le cœur et le portefeuille effarouchés de ce dernier. Malgré la promesse d’une subvention au cercle de généalogie, Eric eut rapidement le sentiment que Baldavini ne s’intéressait plus que très modérément à la généalogie et à l'héraldique ; d’ailleurs, lors de leurs entretiens, il n’en fut bientôt plus du tout question. Si Eric évoquait ces sujets en amorce de discussion, Baldavini déviait rapidement, avec un agacement manifeste. Il était également étonnant que cette sympathie récente n’ait pas conduit Baldavini à proposer une sortie en compagnie de leurs épouses respectives. Mais Eric n’avait aucune raison de s’en plaindre, redoutant plus que tout la mauvaise impression que la vulgaire médiocrité de Tatiania ne manquerait pas de produire sur un personnage de cette qualité.
Baldavini décrivait avec enthousiasme les grands dossiers du développement montpelliérain : rénovation de quartiers, intensification du réseau piétonnier, renforcement du potentiel de la Zone d’Aménagement Concertée de Figuières… Sans aucun prosélytisme, il demeurait toujours au niveau d’un exposé strictement économique. En étant choisi comme confident de renseignements qui dépassaient, de loin, le stade de l’information générale dispensée au citoyen lambda, Langefiel se sentait gonfler d’orgueil. Pourtant, au-delà de la satisfaction de sa vanité pathologique, il subodorait que le but véritable poursuivi par Baldavini n’avait pas encore été révélé.
Puis Baldavini en vint à suggérer à Langefiel de participer, à titre privé, à la société d’économie mixte du futur golf de dix-huit trous de la Pardéranne. Pour Baldavini, en tant qu’élu et donc initiateur public de ce projet, une prise d’intérêt était évidemment exclue puisque totalement illégale. Langefiel avait certes un confortable patrimoine composé essentiellement de biens immobiliers, mais ses liquidités étaient réduites. De plus, la grande bourgeoisie et les gros industriels de Montpellier et de la région n’avaient nullement besoin de l’apport financier d’Eric pour constituer le pôle privé destiné à donner corps à ce projet. Un obscur petit prof d'université n'avait pas sa place dans le cénacle politico-financier montpelliérain. Non, Baldavini n’était pas encore au cœur du sujet ! Langefiel comprit qu’il lui fallait effectuer le premier pas afin que Baldavini se dévoile tout à fait.
- Vous savez Michel, je n’ai vraiment pas l’envergure financière suffisante pour investir dans un tel projet. Et je le regrette ! Vous m’avez absolument convaincu que ceux qui participeront au développement de notre ville feront, de surcroît, une excellente opération pour eux-mêmes !
- C’est dommage Eric. Mais vous avez peut-être une autre solution… Je dois dîner un de ces jours prochains, avec quelques amis. J’aimerais que vous vous joigniez à nous.
C’est ainsi que Langefiel fit la connaissance de Claude Papalian et André Prudhomme, conseillers régionaux, ainsi que de deux entrepreneurs de travaux publics, Jean Pénin et Michel Bonier. A partir de là, les discussions devinrent ouvertes et l’enjeu plus clair. Langefiel s’était vu proposer de créer une société d’investissement grâce à des fonds qui lui seraient apportés par ses interlocuteurs. Simultanément, Langefiel rétrocéderait la quasi-totalité de ses parts à de nouveaux actionnaires dont les noms n’étaient pas inscrits sur l’acte sous seing privé non daté. En résumé, Langefiel devait accepter de servir de prête-nom, en contrepartie d’une infime -mais fort juteuse- participation à cette société, sans débourser un centime. De plus, Langefiel recevrait trois millions d'euros en liquide. Langefiel, qui n’avait jamais été torturé ni encombré par une quelconque forme de morale, avait été effrayé par l’énormité de l’opération et les risques encourus. Mais l’attrait du gain et l’évidente maîtrise de ses éventuels partenaires avaient vite emporté sa décision.
~ * ~Deux mois plus tard, à l’aéroport Montpellier-Méditerrannée, Langefiel avait attendu le vol Air France en provenance de Paris sur lequel se trouvait Pénin, l’un des deux entrepreneurs véreux. Puis, à la sortie des voyageurs, Eric avait pris possession d’une valise de billets. Il avait été mortifié que le chauffeur de taxi l’oblige à se séparer de son précieux chargement pour le placer dans le coffre de la voiture. Arrivé à destination, il avait couru vers son immeuble, s’était engouffré dans l’ascenseur, avait ouvert sa porte en faisant par deux fois, dans son excitation, tomber ses clés. Il s’était ensuite précipité dans son bureau en refermant derrière lui, repoussant au passage avec brutalité cette gourdasse de Tatiana qui s'avançait, les lèvres tendues, pour souhaiter la bienvenue à son époux chéri. Il avait contemplé longtemps le contenu de la valise, tenté de compter les billets, se trompant, recommençant, y renonçant tant son trouble était grand. Samedi, dix-huit heures vingt-cinq ! Trop tard pour déposer l’argent à sa banque. D’ailleurs, il lui faudrait changer d’agence pour ne pas susciter l’étonnement de son chargé de compte. Peut-être même répartir la somme entre plusieurs établissements. Voilà ! C’est exactement ce qu’il ferait dès lundi matin. Dans l’intervalle, il veillerait son magot. Il ne dormirait pas! Mais il fallait d’abord compter cet argent ! Il était certain que la somme exacte y était. Mais il voulait, il avait besoin de compter et recompter cette fortune pour réaliser vraiment, pour communier avec les billets. Il avait repris son comptage, s’était trompé encore et avait décidé de faire appel à Tatiana. Qu’elle serve à quelque chose, cette idiote, au moins une fois dans sa vie !
- Tatiana !
- Oui, mon chéri ?
- Viens dans mon bureau !
- Attends un moment, mon chéri. Je mets le lave-linge en marche et j’arrive.
- Ne m’emmerde pas avec ton foutu linge ! Je te dis de venir tout de suite ! Dépêche-toi !
Tatiana avait émis un petit couinement de contrariété, mais elle s’était exécutée docilement sans protester.
Au fond, puisque Eric ne pouvait exhiber son butin devant des tiers, il avait été heureux, une fois n’est pas coutume, que Tatiana fût le témoin de sa plus belle réussite. Tatiana, pantelante et bouche bée, avait regardé les tas de coupures d'euros empilés sur le bureau directoire d’Eric.
- Mais qu’est-ce que c’est, chéri ?
- Tu vois bien ce que c’est, espèce d’andouille ! C’est pas des sucres d’orge ! Ne pose pas de question débile ! Je ne te demande pas de débiter des âneries, mais seulement de compter avec moi, un point c’est tout !
Tout en abreuvant d’injures Tatiana parce qu’elle s’était trompée à plusieurs reprises, Langefiel avait fini par mener son entreprise à terme. Pas un euro ne manquait. Trois millions d'euros ! Tatiana avait fixé cette masse d’argent, ébahie, n’osant plus questionner Eric. Derrière les épais verres des lunettes, les petits yeux porcins de Langefiel allaient et venaient de l’argent au visage benêt de son épouse. Des sentiments mêlés de puissance, de mépris et de désir pervers l’envahissaient. Il s’était ébroué pour recouvrer ses esprits et avait aboyé :
- J’ai faim. Va me préparer à manger et sers-moi dans le bureau !
Quand Tatiana eut déposé devant lui un plateau-repas, elle fit mine de s'asseoir face à lui pour lui tenir compagnie, mais il la congédia sans ménagement:
- Allez, maintenant évacue! J’ai besoin de réfléchir. Et débranche le téléphone ! Je ne veux pas être emmerdé par ta mère !
Les événements dépassaient visiblement Tatiana. Eric l’avait expulsée avec rudesse du bureau et avait refermé à clé, afin de s’isoler. Elle était demeurée un instant devant le panneau, bouche bée, puis, autant par la force de l’habitude que par véritable détresse, elle s’était mise à pleurer.
Langefiel avait mangé avec voracité sans quitter du regard son riche étalage. Il avait compté encore quelques liasses, pour le plaisir. Il avait entendu le son de la télévision derrière la porte. Cette idiote était certainement captivée par une de ses inepties favorites ! Une nouvelle fois, il avait mesuré la hauteur qui séparait les cimes sur lesquelles il planait et l’abîme dans lequel pataugerait inexorablement cette imbécile pour le reste de son existence ! Plus que jamais, Tatiana l’énervait prodigieusement ! Et, de par ses instincts déviants, Eric eut envie d’aller la prendre, là-bas sur le canapé du salon, en la pinçant et la flagellant durement. C’était dans ces moments où il libérait ses pulsions sexuelles que s’exprimaient avec extase la supériorité et le mépris d’Eric.
Non ! Langefiel chassa de son esprit les fantasmes qui l’assaillaient. Ce n’était pas le moment !
Il était resté longtemps, seul, avec son argent. L’image d’un Harpagon s’était imposée à lui. Langefiel, habituellement sans aucun humour, avait souri à cette évocation ; son sourire s’était transformé en un ricanement de dément :
- Ridicule ! Ridicule ? Qui est ridicule ? Ceux qui riraient de me voir ainsi ou moi avec ces trois millions d'euros ? Trois millions d'euros ! Trois millions ! TROIS MILLIONS D'EUROS !
Eric avait éclaté d’un rire sadique et triomphant, avant de s’interrompre, subitement étreint par une terrible anxiété. Il s’était dirigé vers la porte, avait ouvert et appelé Tatiana du seuil, refusant de s’éloigner trop de son argent.
- TATIANA ! TA-TIA-NA !!!
- Oui, mon chéri ?
- Viens voir ! Vite !
- Qu'est-ce que tu veux, mon chéri?
- Ecoute-moi bien ! Tu vas laisser cette porte fermée jusqu’à lundi et n’ouvrir à personne si on sonne, dit-il en désignant l’entrée de l’appartement. Tu as bien compris ?
- Oui mon chéri, mais la concierge doit venir me voir demain matin pour prendre la mesure des fenêtres pour les rideaux…
- JE M’EN FOUS ! Je m’en fous de la concierge, je m'en fous de toi et je m'en fous de vos rideaux ! Tu m’obéis et tu fermes aussi les volets roulants ! ET TOUT DE SUITE !
Langefiel avait refermé la porte violemment, hors de lui ! En pleine crise de paranoïa, car l’appartement se situait au quatrième étage ! Il avait lui-même déroulé le store de son bureau pour se couper de ce monde hostile qui pouvait menacer son bien, le menacer lui dans ce qu'il avait de plus précieux.
Après plusieurs heure de veille, Eric avait finalement été vaincu par le sommeil. Lorsqu’il avait recouvré ses esprits, assis à son bureau, la tête posée sur ses bras croisés, il ressentit une lourde ankylose du bras droit et une légère douleur sur le haut du front dues à la position inconfortable prolongée. Il avait surtout besoin d’aller aux toilettes. La pendule accrochée au mur en face de lui indiquait dix heures trente.
Indécis, il avait regardé l’argent, puis ne pouvant plus se contenir, il s’était résolu à sortir et charger Tatiana de prendre le relais de la garde de son trésor.
- TATIA… La voix d’Eric s’était étranglée, tant la rage l’étouffait : le salon était inondé de lumière ! La baie vitrée était fermée, mais cette abrutie avait ouvert le volet du balcon !
Tatiana, assise dans le canapé, s’était tournée vers lui et avait risqué timidement :
- Bonjour, chéri.
La réponse d’Eric avait été vociférée :
- Je t’ai dit de laisser ce volet fermé ! Je ne peux rien te demander ! Tu es vraiment trop conne !
Instantanément, Tatiana adopta un trémolo larmoyant :
- Mais chéri, ce n’est pas de ma faute. Il ne marche pas. J’ai essayé de le débloquer, mais je n’y suis pas arrivé. Et je n'ai pas voulu te déran…
- LA FERME ! Je dois tout faire moi-même ! Tu es complètement nulle !
Langefiel, furieux, avait tenté de manœuvrer la manivelle du store et constaté le blocage. Il s’était alors hissé sur le tabouret dont avait dû se servir inutilement cette incapable de Tatiana, pour atteindre le mécanisme d’enroulement. Tatiana, qui l’avait suivi, avait dit d’une petite voix :
- Sois prudent mon chéri !
- Ah, toi, fous-moi la paix, triple buse !
- Attends, mon chéri, je vais te tenir avait osé insister Tatiana, en s’accrochant au pull-over d’Eric.
Débordant de haine, sentant une envie de meurtre le submerger, Langefiel fut tenté de la rejeter d’un violent coup de pied, mais avait préféré se concentrer sur l’indispensable réparation.
Soudainement, il avait senti le tabouret se dérober sous lui. Il avait battu l’air frénétiquement de ses petits bras pour tenter de se rétablir. Il avait cru un instant parvenir à éviter le vide et retomber en arrière sur le balcon. Mais ses tibias avaient heurté le haut de la balustrade et il avait basculé en avant, plongeant tête la première vers le béton éblouissant du trottoir. La stupeur l’avait empêché de manifester sa terreur. Il n’avait pas crié, tandis que le hurlement désespéré et strident de Tatiania avait occupé tout l’espace et le temps dont il eut conscience : environ vingt mètres et deux secondes…
~ * ~
Tatiania, vêtue de noir, hébétée et soutenue par sa mère, fixe un des grands cyprès du cimetière de Fabrègues, à onze kilomètres de Montpellier. Elle reçoit les condoléances d’un cercle restreint de collègues d’Eric, de quelques étudiants ainsi que de rares voisins venus témoigner leur sympathie à la veuve. Tatiania répond machinalement à chacun, balbutiant des bribes de remerciements incompréhensibles. Elle n’entend pas vraiment ce que lui disent ces gens dont la plupart lui sont inconnus. Derrière le masque hagard, son cerveau fonctionne parfaitement. Elle est plus lucide qu'elle ne l'a jamais été et ses idées la portent déjà loin de ce lieu, ailleurs, dans des paysages de vacances en harmonie avec la légèreté de son cœur.
- Ce tabouret de cuisine, je devais le jeter. J’avais bien vu que ses pieds ne tenaient plus que par deux vis à peine fixées dans le bois compressé complètement pourri. Lorsque le store s’est bloqué, j’ai eu cette idée ! J’ai attendu pendant des heures qu’il ressorte de son bureau. Je n’étais pas certaine que le tabouret céderait, mais j’étais décidée à ce qu’il n’y ait pas de seconde tentative. Je le tenais agrippé par l’arrière de son chandail. Eric croyait que c’était par sécurité. Lorsque je l’ai senti vaciller, j’ai cru qu’il allait réussir à sauter hors de danger et à s'en sortir. Alors, j’ai imprimé une poussée sur ses reins. Pas fort. Presque rien. Mais cela a suffi pour qu’il tombe. Il me prenait pour une idiote ! Ils me prennent tous pour une idiote. Je m’en moque maintenant ! Je suis libérée ! Libre ! Riche et libre !
Une si jolie mélodie
"André rêvait qu'il se penchait au bord de lui-même comme au bord d'un précipice"
(Paul Villeneuve)Je ne me souviens pas de ma vie de chiot. J'ai vu le Monde, pour la première fois "avec ces yeux là", il y a vingt semaines sur le haut plateau de Yates. Dans une fulgurance ! A l'instant même où, beaucoup plus à l'ouest, le corps d'Emma se disloquait sur les rochers qui assiègent les falaises de Pity Bay.
Je ne me rappelle pas non plus d'une seule émotion qui m'ait pénétrée à cette seconde. Je n'avais conservé ni la peur ni la douleur d'Emma. Je n'avais pas davantage été frappée de stupeur lorsque le mystère de la mort –et de la vie ! - m'avait été révélé. Je savais seulement et je vivais uniquement l'urgence de rejoindre André.
Il m'a fallu six jours et cinq nuits de course obsédée sur le schiste gelé, à travers les ronces, pour rallier le cottage. J’avais les pattes en sang, le pelage arraché par larges plaques et le cuir déchiré. Mais je savais le chemin : rien ni personne n'aurait pu m'empêcher de retrouver André. Chaque seconde perdue, par un quelconque détour ou une allure plus raisonnable, m’eut infligé une plus grande souffrance que les plaies qui marquaient mon nouveau corps.
Je suis arrivée après l'enterrement d'Emma. Naturellement, je ne l'ai appris que plus tard. Malgré le froid de décembre, la cheminée ne fumait pas. Emma entretenait pourtant le feu en permanence depuis plus de deux mois... J'ai attendu quelques minutes devant la maison avant d'en faire le tour, guettant le moindre bruit qui m'eut signalé la présence d'André.
J'étais consciente que ma condition nouvelle me dictait de demeurer à l'extérieur et d'attendre qu'André apparaisse enfin. Mais je n'ai pu résister longtemps au besoin de franchir la porte d'entrée restée ouverte et d'aller vers lui.
Je l'ai trouvé endormi dans le salon. Assommé plutôt. La bouteille qu'il tenait encore serrée contre son flanc et dont une partie du contenu s'était répandu sur sa chemise, autant que les effluves qui me parvenaient, m'ont renseignée sur son désespoir. A terre, d'autres bouteilles et des débris de verre témoignaient de son malheur. Et de son amour...
Il commençait à faire sombre et plus froid encore lorsqu'il s'est réveillé. Il lui a fallu plusieurs minutes pour se redresser, difficilement. Il ne m'a pas aperçue tout de suite. Et même lorsque son regard fiévreux s'est porté vers moi, je ne suis pas certaine qu'il m'ait remarquée à ce moment précis.
Ce n'est qu'en se levant, tout aussi péniblement, qu'il a semblé me considérer. Ses yeux se sont à peine animés, allant vers la porte ouverte et revenant à moi. L'explication sans intérêt de ma présence ayant lentement cheminé dans son esprit, il a simplement haussé les épaules sans me prêter plus d'attention.
Il a vidé la bouteille qu'il n'avait toujours pas lâchée, l'a laissé rouler à ses pieds et s'est dirigé d'une démarche incertaine vers la grande lampe du buffet qu'il a allumée. En le voyant ainsi, en pleine lumière, j'ai partagé plus encore sa détresse. A l'évidence, il ne s'était pas rasé et n'avait pas dû manger non plus depuis l'accident...
Il est immédiatement revenu s'effondrer sur le canapé, ramenant sur lui une couverture imbibée et souillée. Sans doute, cette clarté artificielle l'aidait-elle à réduire des cauchemars que l'alcool seul ne parvenait pas à endiguer.
~ * ~
Deux jours se sont encore écoulés, pendant lesquels les seuls déplacements d’André furent vers la cave, pour des approvisionnements en vin. A aucun moment, il ne s’alimenta. Il se contentait de boire au goulot, entre deux périodes de quasi-coma. Il n’avait pas refermé la porte du cottage, ce qui me permettait d’aller et venir sans solliciter son intervention. Au troisième matin de ma présence à ses côtés, André se leva à l’aube et s’adressa à moi pour la première fois.
- Toujours là, le chien ? Tu veux m’adopter ? Tu fais une sacrée affaire ! me dit-il d’un ton ironique et désabusé.
Son attitude, dans les instants qui suivirent, me laissèrent croire à un ressaisissement de sa part. Il déposa une assiette au sol et y versa le contenu d’une boîte de corned beef.
- Tiens le chien, viens manger.
Il alla prendre une douche et se rasa, ce que je ne l’avais pas vu faire non plus depuis mon arrivée. Puis il se prépara du café qu’il accompagna de biscuits secs. Une fois son petit déjeuner achevé, il fit du feu dans la cheminée puis entreprit d’évacuer du salon les vestiges de ses beuveries.
Ce renouveau, qui faisait s’éloigner le spectre d’une issue que je redoutais dramatique, me procura un relatif soulagement.
André finissait juste de rendre au cottage un aspect présentable, lorsque nous entendîmes un véhicule s’arrêter dans la cour. Je reconnus le bruit caractéristique de la vieille camionnette de Joseph Mahony, l’épicier de Webscooper, qui nous livrait une fois par semaine. Je compris alors que l’apparente résurrection d’André n’était que le sursaut de dignité d’un être désespéré cherchant à dissimuler aux étrangers les traces de son naufrage moral et physique.
Effectivement, à peine le commerçant reparti, André reprit son errance éthylique. Il ne se souciait naturellement pas de sauvegarder les apparences devant un chien. Cette monotonie destructrice n’était régulièrement interrompue que par le bref intermède des visites de Joseph Mahony. Un changement notable s’opérait pourtant : André me parlait ! Bien sûr, il se parlait surtout à lui-même, en tenant des propos incohérents et souvent inachevés…
- C’est pas ton problème à toi, hein le chien ? C’est fini maintenant… Trop tard… Foutu…
Au bout de quelques semaines, André se tenait toujours à l’écart de tout être humain. Hormis l’épicier Mahony, il refusait tout contact. La recherche délibérée de cet isolement ne rencontrait aucun obstacle, puisque le cottage que j’avais acheté avant notre mariage est situé à 3 kilomètres du village de Webscooper et que notre plus proche voisin, John Hence, réside à plus de 500 mètres.
Malgré cela, le comportement d’André avait fini par évoluer de manière légèrement positive : nous sortions chaque jour pour une courte promenade jusqu’au belvédère de Pity Bay, où nous demeurions quelques minutes. Je comprenais parfaitement le motif de ce pèlerinage. C’est cette même promenade qu’effectuaient chaque jour André et Emma. Ils aimaient s’asseoir sur le sol au belvédère, lieu non aménagé et qu’ils avaient eux-mêmes baptisé ainsi. Ils y venaient souvent à la fin du jour pour regarder le soleil qui disparaissait au-delà de l’archipel des Hébrides. C’est au belvédère qu’était arrivé l’accident. Emma s’était imprudemment approchée du bord de la falaise pour contempler les flots qui fouettent les rochers, 50 mètres plus bas. Elle avait perdu l’équilibre. André avait tenté de l’agripper, sans pouvoir la retenir. Emma était tombée dans un hurlement. Emma était morte.
Les monologues d’André devenaient plus cohérents. D’ailleurs, il buvait moins. J’aurais tellement voulu pouvoir, moi aussi, lui parler. Lorsque je voyais sa tristesse s’accentuer, je le suppliais, dans un cri silencieux :
- Regarde mes yeux, André ! Regarde les yeux d’Emma ! Reconnais-moi !
Mais André ne voyait qu’un chien, dérisoire lueur dans son univers de tourments, piètre agrément de sa solitude.
J’étais simplement " le chien ". Cela me convenait. Je n’étais plus vraiment Emma, mais je n’aurais pas voulu être appelée d’un autre nom par André. L’amour d’Emma était toujours en moi, grandi par la tragédie et le spectacle du deuil douloureux d’André.
Il me disait des fragments de son histoire, des tranches de vie que je connaissais, parce qu’Emma les avait partagés ou qu’il les lui avait racontés.
- Tu vois, le chien, c’est ici, à Pity Bay que j’ai connu le plus grand bonheur… et puis le malheur pour finir.
~ * ~
Au fil en pointillé de ses récits, je revoyais la rencontre d’Emma et d’André. Une veuve quadragénaire et fortunée rencontrant sur la Côte d’Azur un écrivain débutant en quête d’éditeur, sans le sou et de seize ans son cadet ; un mariage dans la plus stricte intimité à Webscooper trois mois plus tard. Le premier roman d’André n’avait jamais été publié, mais toute dévotion consacrée à Emma, il ne paraissait plus guère s’en soucier. Consciente que son entourage considérait André comme un coureur de dot, Emma s’était peu à peu éloignée de toutes ses anciennes relations. Pendant les trois premières années, le couple avait partagé son temps entre l’appartement parisien du marais, la villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat, le cottage de Webscooper et divers voyages en Europe et en Afrique. Puis, la présence de l’autre suffisant à elle seule à peupler l’univers, André et Emma s’étaient définitivement fixés à Webscooper, comme hors du temps. Les seules escapades du couple hors du Nord-Ouest de l’Angleterre étaient, six fois par an pour deux ou trois jours, à destination de Londres et Paris où Emma rencontrait ses avocats d’affaires avec lesquels elle n’avait, hors ces entrevues ponctuelles, que des relations par téléphone, fax ou courrier électronique. André ne s’intéressait en rien aux entreprises financières d’Emma, ne posait jamais aucune question. Lorsque Emma songeait à ses anciens amis soupçonneux à l’encontre d’André, elle n’éprouvait aucune colère ni rancune. Seulement de la pitié pour ceux et celles qui ne pouvaient imaginer et ne connaîtraient jamais un amour d’une telle plénitude.
Pourquoi André aurait-il supporté pendant quatre ans cette existence austère dans une modeste bâtisse perdue dans les brumes du Sutherland, alors qu’il aurait pu exiger – et obtenir sans rencontrer la moindre objection – de vivre fastueusement ailleurs ? La réponse était évidente, simple et limpide : la passion d’Emma n’avait d’égale que celle d’André. Rien ni personne d’autre ne comptait.
A défaut de voir ses œuvres reconnues, André continuait à écrire pour son seul plaisir. Il partait seul flâner dans la campagne environnante pour y chercher l’inspiration, généralement toute la matinée. Il revenait déjeuner, puis me consacrait toute l’après-midi, avant de s’isoler dans la soirée pour noircir quelques feuillets.
Lorsqu’il se lançait dans ses évocations, je les écoutais tout en laissant mon esprit inquiet vagabonder, parce qu’elles ne m’apprenaient rien sinon qu’André existait sans vivre vraiment, tourné vers le passé, sans projet ni envie décelable d’imaginer un futur quelconque. Un jour pourtant, un mot, un seul mot, me fit tendre l’oreille :
- Sarah…
Ce prénom avait été prononcé à voix basse, d’un ton presque étranglé, avant qu’André se taise tout à fait, l’air plus sombre que jamais. Il s’était levé immédiatement pour rentrer. Sans savoir encore pourquoi, j’étais transie d’anxiété ; sentiment justifié puisque André avait recommencé à boire dès notre arrivée au cottage. Sarah… Ce prénom me rappelait quelqu’un, mais je ne parvenais pas à situer un visage ou un événement…
Malgré mes angoisses, nous sommes retournés au belvédère le lendemain. Cette fois-ci, le feuilletage de son carnet de souvenirs a été un véritable coup de poignard pour moi. Sarah ! Sarah Appleton ! Je m’en souvenais à présent ! Cette jeune étudiante en informatique passait des vacances à Webscooper, dans sa famille, l’été dernier. Sur la recommandation de son oncle, Joseph Mahony, j’avais fait appel à ses services pour la saisie, sur traitement de texte, du second roman d’André. Cette œuvre ne serait peut-être pas davantage publiée que la première, mais André tenait à lui donner une forme plus achevée qu’un simple manuscrit raturé. Miss Mahony avait passé une quinzaine de journées au cottage. Elle travaillait seule au début, mais ayant de plus en plus de mal avec l’écriture brouillonne d’André elle avait rapidement dû lui demander de lui décrypter des passages entiers. André avait donc fini par demeurer en permanence à ses côtés. Miss Manony était timide et discrète et j’avais une totale confiance en André… Et je découvrais qu’ils avaient eu une liaison. Pourquoi cela s’était-il passé ? Parce que Sarah Mahony avait vingt-cinq ans de moins qu’Emma ! Quelle naïveté ! La révélation de cette trahison me donnait le sentiment physique d’une agonie qui s’acheva avec le coup de grâce des dernières paroles d’André :
- Je suis tombé amoureux de Sarah, comme je ne l’ai jamais été. Je voulais refaire ma vie avec elle. J’étais convaincu qu’elle m’aimait aussi. Mais elle ne voulait plus de ces rendez-vous clandestins. Elle m’a demandé de quitter Emma. J’aurais tant voulu que ce soit possible. Je ne supportais plus ses attentions maternelles ; je ne pouvais plus vivre et dormir avec cette vieille femme ; elle me faisait honte et je me dégoûtais. Mais je savais que si je quittais Emma et que je demandais le divorce, ses avocats se chargeraient de me faire retourner à mon dénuement passé. Et j’avais conscience que Sarah ne se contenterait pas éternellement de partager l’existence médiocre d’un écrivain raté. Alors, le jour où j’ai vu Emma s’approcher du bord de la falaise, j’ai souhaité qu’elle tombe. La providence a presque exaucé mes vœux. Elle a trébuché. Je me suis précipité, par réflexe, pour l’agripper. Et puis, en une fraction de seconde, sans que je le décide vraiment, je l’ai relâchée. Elle est tombée en criant. Je me suis détourné, sans oser regarder en bas. De toutes façons, je savais qu’elle n’avait pas pu survivre à la chute. C’était horrible, mais j’étais libre.
Je suis allé donner l’alerte chez le vieux John Hence qui a prévenu la police. Je n’ai pas eu à jouer un rôle. J’étais vraiment bouleversé. Terrifié même par ce qui s’était passé. Tout le monde a cru à un accident. Sauf peut-être Hence qui m’a regardé bizarrement à l’enterrement. Il m’avait rencontré avec Sarah plusieurs fois sur les falaises. Je crois qu’il n’a rien dit à personne, mais ce qu’il pouvait penser me faisait peur. Maintenant, ça m’est égal…
Le lendemain de l’enterrement, j’ai donné rendez-vous à Sarah, ici au belvédère. Je lui ai dit ce que j’avais fait pour elle et que plus rien ne nous empêchait de vivre ensemble, que nous pouvions partir n’importe où. Sa réaction m’a crucifié. Elle était épouvantée. Elle m’a repoussée. Elle m’a dit qu’elle n’avait jamais voulu cela, que je lui faisais horreur, que j’étais un assassin. Mais, plus que ce qu'elle m'a dit, le dégoût que j'ai lu dans ses yeux était terrible. Elle s’est enfuie en courant. Le lendemain, elle était partie.
- Voilà le chien, tu vois ce sont ces maudites falaises qui ont détruit ma vie. Ces falaises… et Emma, même morte !
André a proféré cette dernière phrase d’un ton haineux en s’approchant du précipice, comme pour chercher à apercevoir, plus bas, le spectre d’Emma. Il s’est mis à sangloter :
- Sarah, ma Sarah…
Il ne regrettait pas la mort d’Emma, il pleurait cette garce qui ne l’avait pas assez aimé pour supporter son crime. C’est ce qui m’a fait réagir. J’ai bondi. J’ai frappé des quatre pattes André dans le dos, le propulsant vers le vide. Il a plongé en gesticulant, mais n’a pas crié. J’ai manqué de peu basculer également. Je suis repartie vers le cottage. Je savais qu’André ne fermait aucune porte à clé et je me souvenais que celle sur l’arrière de la maison s’ouvrait d’une simple poussée… J’ai réussi à pénétrer à l’intérieur et j’ai attendu, en repensant à ma vie, à la vie d’Emma. En définitive, derrière l’illusion du bonheur, une vie de chien depuis longtemps !
~ * ~
Le surlendemain, l’épicier Mahony est revenu pour sa livraison hebdomadaire. Comme il n’obtenait pas de réponse après avoir frappé à la porte, il est entré et a déposé les conserves sur la table de la cuisine et la viande et les légumes dans le réfrigérateur. Il a paru surpris de me voir seule dans la maison, mais pas le moins du monde alarmé par l’absence d’André.
- Bon, je suppose que ce n’est pas toi qui va régler la note, le chien, alors on verra ça la semaine prochaine dit-il en me caressant affectueusement. A son retour, Mahony s’est inquiété en découvrant les provisions qui n’avaient pas bougé de place. Il est allé voir notre voisin, John Hence, pour lui demander s’il avait vu André. Je l’ai suivi car, si j’avais pu boire à la mare située derrière le cottage, j’étais réellement affamée. C’est ainsi qu’ont débuté les recherches qui ont permis de découvrir le corps d’André et que John m’a recueillie, puis adoptée quand il fut établi que mon précédent "maître" ne reviendrait plus. Par un policier venu, par routine, interroger John, j’ai appris que l’évidence s’imposait : André s’était suicidé parce que la disparition d’Emma lui était insupportable…
Emma ne connaissait guère davantage John Hence que les autres habitants de Wescooper, mais leurs rares rencontres, sur les falaises ou au village, lui avaient donné l’impression d’un vieil homme aimable et discret. Après deux mois passés à ses côtés, j’ai conforté cette opinion. C’est un homme bon. Je me demande souvent si, comme l’avait craint André, John avait soupçonné que la mort d’Emma ne fut pas naturelle. Mais jamais, dans les conversations qu’il tenait avec ses interlocuteurs, je ne l’ai entendu évoquer ce sujet.
Nous partons chaque matin vers neuf heures, John et moi, pour une ballade de près de deux heures qui nous mène jusqu'au village de Webscooper, en passant par le belvédère de Pity Bay. Nous nous y arrêtons pendant quelques minutes. John scrute l’horizon en souriant, comme s’il se souvenait sans nostalgie de son passé de marin. Cette pause rituelle ne m’a pas surprise. John était une des seules personnes qu’André et moi rencontrions sur le chemin des falaises. Il nous saluait d’un geste de la main avant de s’éloigner discrètement.
Ce retour quotidien au belvédère fut d’abord nécessaire et douloureux, tout comme ce le fut pour André. Maintenant, cette halte ne génère plus chez moi qu’indifférence, voire impatience : l’essentiel est ailleurs, plus loin… Ce qui m’importe désormais n’est pas non plus au cimetière de Webscooper, où John passe fleurir la tombe de son épouse de quelques roses cueillies dans son jardin. Je ne m’éloigne plus vers les tombes d’Emma et d’André, disposées côte à côte : bien que je respecte l’acte de commémoration de John, je n’éprouve aucun besoin moi-même d’honorer des monuments funéraires qui n’ont pas plus de signification que les dépouilles qu’ils renferment. Au pub où John va saluer ses amis, je dois encore patienter.
L’exultation débute sur le retour qui s’effectue par un autre chemin, plus court, à l’intérieur des terres. Il nous faut sortir du village en passant devant la maison des Scofield. Sur la véranda, depuis peu, suspendue à une potence, il y a une grande cage dorée d’où s’élève le chant d’un serin. John écoute cette mélodie, immobile devant la clôture. Il trouve cela très beau. Je l'ai même entendu murmurer que ce chant d'allégresse était une véritable célébration de la vie... Il ne peut pas savoir… C'est tout le contraire ! Moi seule peut comprendre. Les accents pathétiques de cette complainte témoignent que la mémoire est la plus implacable des prisons.
La seule ombre à ma sérénité de l’instant provient de la probabilité, qu’à la fin de la saison chaude, Mrs Scofield rentre la cage à l’intérieur de la maison. Je ne pourrai plus voir l’oiseau. Je devrai me contenter de l’écouter jusqu’au printemps suivant. Mais il reste encore bien de belles journées, alors Carpe Diem…
Enfin, je donne le signal du départ par un bref aboiement adressé à l'oiseau plus qu'à John.
- Chante encore, pleure encore, André mon amour. Même si je sais que ce n'est pas pour moi. Je reviendrai demain…